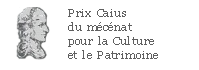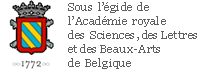C'est très simple...
Il suffit de poser votre candidature ici.
Il suffit de poser votre candidature ici.
Vous pouvez soutenir le projet Koregos de plusieurs façons. Cliquez ici pour tout savoir.
Paul Gauguin
 Paul Gauguin (né en 1848 à Paris – mort en 1903 à Atuona sur l’île d’Hiva Oa, Polynésie française), le peintre d’un monde exotique et radieux, doit sa place dans l’histoire de l’art à ses représentations somptueusement colorées des îles des mers du Sud. Ses œuvres novatrices comptent parmi les icônes de l’art moderne. Par leurs couleurs « pures » et éclatantes et par leurs formes planes, elles ont révolutionné l’art et joué un rôle déterminant pour les artistes modernes de la génération suivante. Avant Gauguin, aucun artiste ne s’était consacré à une quête aussi acharnée du bonheur et de la liberté, tant dans sa vie que dans son art. C’est également une des raisons de son immense popularité, demeurée intacte jusqu’à ce jour.
Paul Gauguin (né en 1848 à Paris – mort en 1903 à Atuona sur l’île d’Hiva Oa, Polynésie française), le peintre d’un monde exotique et radieux, doit sa place dans l’histoire de l’art à ses représentations somptueusement colorées des îles des mers du Sud. Ses œuvres novatrices comptent parmi les icônes de l’art moderne. Par leurs couleurs « pures » et éclatantes et par leurs formes planes, elles ont révolutionné l’art et joué un rôle déterminant pour les artistes modernes de la génération suivante. Avant Gauguin, aucun artiste ne s’était consacré à une quête aussi acharnée du bonheur et de la liberté, tant dans sa vie que dans son art. C’est également une des raisons de son immense popularité, demeurée intacte jusqu’à ce jour.
Gauguin a déjà 35 ans quand il décide de renoncer à son existence de courtier en bourse et en assurances pour se consacrer entièrement à la peinture. Le bourgeois se transforme alors en bohème. Au cours de la petite vingtaine d’années qui suit, il produit une œuvre d’une richesse et d’une diversité extrêmes, où peintures et sculptures côtoient dessins, gravures et écrits.
A travers des chefs-d’œuvre uniques provenant des plus grands musées et des plus remarquables collections particulières du monde, l’exposition de la Fondation Beyeler se concentre sur la période de maturité de Gauguin, celle où l’artiste a trouvé son style personnel. Après les œuvres novatrices réalisées en Bretagne, le parcours se poursuit par les célèbres tableaux qu’il peint en Polynésie –d’abord à Tahiti, puis dans l’archipel des Marquises. Ce sont ces œuvres qui font découvrir, mieux que toutes autres, les innovations formelles et la diversité de contenu du langage pictural expressif de Gauguin. Si la peinture unique de Gauguin occupe le centre de cette exposition, sa sculpture inspirée de la culture maorie se voit également accorder une place importante, un certain nombre d’œuvres clés engageant ainsi un dialogue avec ses célèbres toiles. Sur le plan du contenu, l’accent est porté sur le traitement novateur de la figure et du paysage, lesquels entretiennent une interaction harmonieuse dans l’univers pictural de Gauguin.
Dégoûté par les milieux artistiques parisiens, Gauguin décide d’explorer la Bretagne, plus proche de la nature, espérant y trouver de nouvelles impulsions artistiques. Lors de son deuxième séjour dans le village breton de Pont-Aven, au début de 1888, il met au point son style personnel, dénommé « synthétisme ». Il y utilise des couleurs pures et lumineuses qui entretiennent de puissants contrastes, et juxtapose des formes clairement délimitées, accentuant la planéité du tableau. A la différence des impressionnistes, Gauguin ne cherche plus à reproduire la surface perceptible de la réalité : il se met en quête d’une vérité plus profonde, au-delà du visible. Un groupe d’artistes, connu sous le nom d’ « Ecole de Pont-Aven », se rassemble alors autour de lui. En Bretagne, Gauguin peint des paysages idylliques et des scènes de la vie rurale, des représentations sacrées véritablement novatrices et des autoportraits complexes, qui révèlent l’artiste sous diverses facettes. Toujours en quête d’authenticité et bien décidé à poursuivre sa démarche artistique, Gauguin décide d’émigrer à Tahiti en 1891. Il croit trouver sur cette île du Pacifique un paradis tropical intact, où il pourra se développer librement en tant qu’artiste. Mais il constate rapidement que la réalité tahitienne est loin de correspondre à ses images idéalisées ; en effet, la colonisation et la christianisation ont déjà largement détruit le « paradis » qu’il espérait trouver. Gauguin cherche à compenser cette déception à travers son art, dans lequel il célèbre la beauté exotique rêvée des paysages polynésiens et de leur population indigène dans des toiles aux couleurs somptueuses et dans des sculptures remarquablement expressives, s’inspirant également des mythes et du langage iconographique des peuples océaniens.
Des raisons financières et des problèmes de santé obligent Gauguin à quitter Tahiti en 1893 pour regagner la France. Cependant, le public parisien ne lui accordant pas le succès espéré, il décide de regagner Tahiti dans le courant de l’été 1895. Il y réalise de nouvelles œuvres marquantes dans lesquelles il célèbre son image idéale d’un monde intact et en même temps mystérieux, accédant ainsi à une perfection suprême. Accablé par les difficultés de l’existence et par son état de santé délabré, et désespéré par la mort prématurée de sa fille Aline, Gauguin fait une tentative de suicide dont les conséquences le feront longtemps souffrir. Pendant ce temps, le monde artistique commence enfin à prêter attention à son œuvre, ce qui lui permet de conclure en 1900, avec le galeriste parisien Ambroise Vollard, un contrat lui assurant un certain revenu.
Gauguin se sent de moins en moins à l’aise à Tahiti : il trouve l’île trop européenne et la vie y est devenue trop chère. Il recherche également de nouvelles impressions artistiques. Il se rend alors en 1901 sur l’île d’Hiva Oa dans l’archipel des Marquises, à 1500 kilomètres de Tahiti, et qui passe pour plus sauvage encore. Malgré sa santé délabrée, sa profonde désillusion et des déconvenues de toutes sortes, il réalise encore au cours de ce deuxième séjour dans le Pacifique, des œuvres qui célèbrent la richesse culturelle et la beauté de la Polynésie dans une perfection suprême allant jusqu’à la transfiguration. Aux Marquises, comme il l’avait déjà fait à Tahiti, Gauguin prend également fait et cause pour la population indigène, ce qui lui vaut des démêlés avec l’administration coloniale, qui aboutissent à sa condamnation à une amende et à une peine de prison. Avant que ce jugement ait pu être appliqué, Paul Gauguin meurt, le 8 mai 1903, à 54 ans, malade, solitaire et démuni sur l’île d’Hiva Oa, où sa tombe se trouve encore aujourd’hui.
Associant sérénité rayonnante et sombre mélancolie, les tableaux de Paul Gauguin sont tout à la fois séduisants et énigmatiques. Ils nous livrent un récit fascinant de l’aspiration à un paradis terrestre perdu, d’une vie d’artiste tragique, mouvementée, toujours en voyage entre les cultures, déterminée par la joie et le désespoir, la passion et l’esprit d’aventure. Tiraillé entre une utopie rêvée et la dure réalité, Gauguin était sans doute condamné à l’échec, mais son refus de tout compromis et la singularité absolue de son œuvre ont fait de lui un mythe intemporel.


News
13 February 2015

 Paul Gauguin (né en 1848 à Paris – mort en 1903 à Atuona sur l’île d’Hiva Oa, Polynésie française), le peintre d’un monde exotique et radieux, doit sa place dans l’histoire de l’art à ses représentations somptueusement colorées des îles des mers du Sud. Ses œuvres novatrices comptent parmi les icônes de l’art moderne. Par leurs couleurs « pures » et éclatantes et par leurs formes planes, elles ont révolutionné l’art et joué un rôle déterminant pour les artistes modernes de la génération suivante. Avant Gauguin, aucun artiste ne s’était consacré à une quête aussi acharnée du bonheur et de la liberté, tant dans sa vie que dans son art. C’est également une des raisons de son immense popularité, demeurée intacte jusqu’à ce jour.
Paul Gauguin (né en 1848 à Paris – mort en 1903 à Atuona sur l’île d’Hiva Oa, Polynésie française), le peintre d’un monde exotique et radieux, doit sa place dans l’histoire de l’art à ses représentations somptueusement colorées des îles des mers du Sud. Ses œuvres novatrices comptent parmi les icônes de l’art moderne. Par leurs couleurs « pures » et éclatantes et par leurs formes planes, elles ont révolutionné l’art et joué un rôle déterminant pour les artistes modernes de la génération suivante. Avant Gauguin, aucun artiste ne s’était consacré à une quête aussi acharnée du bonheur et de la liberté, tant dans sa vie que dans son art. C’est également une des raisons de son immense popularité, demeurée intacte jusqu’à ce jour.Gauguin a déjà 35 ans quand il décide de renoncer à son existence de courtier en bourse et en assurances pour se consacrer entièrement à la peinture. Le bourgeois se transforme alors en bohème. Au cours de la petite vingtaine d’années qui suit, il produit une œuvre d’une richesse et d’une diversité extrêmes, où peintures et sculptures côtoient dessins, gravures et écrits.
A travers des chefs-d’œuvre uniques provenant des plus grands musées et des plus remarquables collections particulières du monde, l’exposition de la Fondation Beyeler se concentre sur la période de maturité de Gauguin, celle où l’artiste a trouvé son style personnel. Après les œuvres novatrices réalisées en Bretagne, le parcours se poursuit par les célèbres tableaux qu’il peint en Polynésie –d’abord à Tahiti, puis dans l’archipel des Marquises. Ce sont ces œuvres qui font découvrir, mieux que toutes autres, les innovations formelles et la diversité de contenu du langage pictural expressif de Gauguin. Si la peinture unique de Gauguin occupe le centre de cette exposition, sa sculpture inspirée de la culture maorie se voit également accorder une place importante, un certain nombre d’œuvres clés engageant ainsi un dialogue avec ses célèbres toiles. Sur le plan du contenu, l’accent est porté sur le traitement novateur de la figure et du paysage, lesquels entretiennent une interaction harmonieuse dans l’univers pictural de Gauguin.
Dégoûté par les milieux artistiques parisiens, Gauguin décide d’explorer la Bretagne, plus proche de la nature, espérant y trouver de nouvelles impulsions artistiques. Lors de son deuxième séjour dans le village breton de Pont-Aven, au début de 1888, il met au point son style personnel, dénommé « synthétisme ». Il y utilise des couleurs pures et lumineuses qui entretiennent de puissants contrastes, et juxtapose des formes clairement délimitées, accentuant la planéité du tableau. A la différence des impressionnistes, Gauguin ne cherche plus à reproduire la surface perceptible de la réalité : il se met en quête d’une vérité plus profonde, au-delà du visible. Un groupe d’artistes, connu sous le nom d’ « Ecole de Pont-Aven », se rassemble alors autour de lui. En Bretagne, Gauguin peint des paysages idylliques et des scènes de la vie rurale, des représentations sacrées véritablement novatrices et des autoportraits complexes, qui révèlent l’artiste sous diverses facettes. Toujours en quête d’authenticité et bien décidé à poursuivre sa démarche artistique, Gauguin décide d’émigrer à Tahiti en 1891. Il croit trouver sur cette île du Pacifique un paradis tropical intact, où il pourra se développer librement en tant qu’artiste. Mais il constate rapidement que la réalité tahitienne est loin de correspondre à ses images idéalisées ; en effet, la colonisation et la christianisation ont déjà largement détruit le « paradis » qu’il espérait trouver. Gauguin cherche à compenser cette déception à travers son art, dans lequel il célèbre la beauté exotique rêvée des paysages polynésiens et de leur population indigène dans des toiles aux couleurs somptueuses et dans des sculptures remarquablement expressives, s’inspirant également des mythes et du langage iconographique des peuples océaniens.
Des raisons financières et des problèmes de santé obligent Gauguin à quitter Tahiti en 1893 pour regagner la France. Cependant, le public parisien ne lui accordant pas le succès espéré, il décide de regagner Tahiti dans le courant de l’été 1895. Il y réalise de nouvelles œuvres marquantes dans lesquelles il célèbre son image idéale d’un monde intact et en même temps mystérieux, accédant ainsi à une perfection suprême. Accablé par les difficultés de l’existence et par son état de santé délabré, et désespéré par la mort prématurée de sa fille Aline, Gauguin fait une tentative de suicide dont les conséquences le feront longtemps souffrir. Pendant ce temps, le monde artistique commence enfin à prêter attention à son œuvre, ce qui lui permet de conclure en 1900, avec le galeriste parisien Ambroise Vollard, un contrat lui assurant un certain revenu.
Gauguin se sent de moins en moins à l’aise à Tahiti : il trouve l’île trop européenne et la vie y est devenue trop chère. Il recherche également de nouvelles impressions artistiques. Il se rend alors en 1901 sur l’île d’Hiva Oa dans l’archipel des Marquises, à 1500 kilomètres de Tahiti, et qui passe pour plus sauvage encore. Malgré sa santé délabrée, sa profonde désillusion et des déconvenues de toutes sortes, il réalise encore au cours de ce deuxième séjour dans le Pacifique, des œuvres qui célèbrent la richesse culturelle et la beauté de la Polynésie dans une perfection suprême allant jusqu’à la transfiguration. Aux Marquises, comme il l’avait déjà fait à Tahiti, Gauguin prend également fait et cause pour la population indigène, ce qui lui vaut des démêlés avec l’administration coloniale, qui aboutissent à sa condamnation à une amende et à une peine de prison. Avant que ce jugement ait pu être appliqué, Paul Gauguin meurt, le 8 mai 1903, à 54 ans, malade, solitaire et démuni sur l’île d’Hiva Oa, où sa tombe se trouve encore aujourd’hui.
Associant sérénité rayonnante et sombre mélancolie, les tableaux de Paul Gauguin sont tout à la fois séduisants et énigmatiques. Ils nous livrent un récit fascinant de l’aspiration à un paradis terrestre perdu, d’une vie d’artiste tragique, mouvementée, toujours en voyage entre les cultures, déterminée par la joie et le désespoir, la passion et l’esprit d’aventure. Tiraillé entre une utopie rêvée et la dure réalité, Gauguin était sans doute condamné à l’échec, mais son refus de tout compromis et la singularité absolue de son œuvre ont fait de lui un mythe intemporel.
Informations pratiques

Lieu : Centre de la gravure et de l’image imprimée
10 rue des Amours, 7100 La Louvière (Belgique)
Dates : Du 7 février au 10 mai 2015
Horaire : Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18h00
Lien : www.centredelagravure.be
10 rue des Amours, 7100 La Louvière (Belgique)
Dates : Du 7 février au 10 mai 2015
Horaire : Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18h00
Lien : www.centredelagravure.be
Galerie

Galery

| 3 pictures | Diaporama |