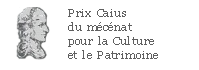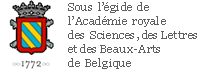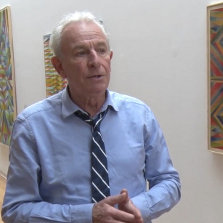Note de la rédaction

Ce reporticle est publié à la suite de l’exposition Jacques Charlier – Peinture pour tous qui a tenu place au MAC’s, à Hornu, du 28 février au 22 mai 2016.
Peintures pour tous

L’œuvre de Jacques Charlier tient de la science-fiction. Au monde de l’art qu’il caricature depuis les années 1970, il applique la même perspective forcée (1) que les auteurs de S.F. au monde technoscientifique. Avec ses effets vertigineux et expressionnistes de plongée et de contre-plongée, cette optique, qualifiée aussi de maximaliste (2), produit un tableau inquiétant du décor où l’humanité, ou plutôt l’espèce humaine, est désormais condamnée à vivre. De cette manière, Charlier saisit tous les excès – les Anciens Grecs disaient l’hubris (3) – d’une planète de l’art qui, à force de transgressions, de spéculations et de mégalomanie, a dévié de sa trajectoire, transformant son utopie moderniste en une dystopie (4) postmoderne.
Au milieu des années 1970, une critique radicale de cette dérive émane du camp de l’art conceptuel auquel appartiennent des artistes aussi différents en apparence que Marcel Broodthaers, Daniel Buren ou Art & Language. C’est à cette même période que Charlier prend pour cible le rituel mondain des vernissages d’exposition à travers plusieurs séries de reportages photographiques qu’il expose dans une sorte de mise en abyme, de vertige critique (5). C’est aussi l’époque où Hans Haacke s’attache à montrer les connivences entre le monde de l’art et la sphère des affaires. En somme, les artistes les plus engagés politiquement commencent à dénoncer la récupération de la contre-culture des sixties par les institutions. Le critique anglais Michael Archer observe en ce sens : « La prise de conscience, dans le domaine des idées, que la recherche, loin d'être une investigation désintéressée, était presque totalement dictée par des enjeux économiques et politiques extérieurs à son objet, venait contredire l'idée que le développement du savoir allait dans le sens d'une connaissance éclairée. Enfin, l'art contemporain a depuis longtemps cessé de penser la nouveauté comme une arme potentielle, si jamais il le fit. La diversité de l'art, même radicale et politique, devint désormais la norme académique et institutionnelle. Le soutien à l'art public, à certains artistes et à la performance par les collectivités étatiques et locales trouvait un écho dans l'enseignement où les universités élargissaient leur champ disciplinaire pour offrir des cours non seulement sur la peinture et la sculpture, mais aussi sur la peinture murale et les disciplines en techniques mixtes. Le modernisme, du moins tel qu'il avait été compris, était, pensait-on, arrivé à son terme ; le monde devait désormais être considéré comme postmoderne. L'utopie sera alors remplacée par la dystopie. » (6).
Ainsi que le souligne fort à propos mon estimé collègue Sergio Bonati, Jacques Charlier est un « autodidacte doué » ; « un artiste toutes disciplines confondues ».
La diversité, dès lors, serait le moteur et l’essence de l’entreprise générale de déménagement cérébral du monde de l’art de ce dilettante professionnel, de cet amateur plein temps. Mais comment, constamment, renouveler et poursuivre cette activité qui n’en touche pas une, qui abandonne les unes après les autres toutes velléités de se complaire dans un schéma ou une forme précis ? C’est là la question que son œuvre entier soulève. Rien n’est fixé, tout est libre ! Et Leo Josefstein l’exprime clairement quand il écrit : « À chaque planche anatomique, son diagnostic cinglant ». À chaque planche, en effet, à chaque prise (d’une forteresse) et reprise (d’un refrain), vient se plaquer avec virulence une image qui dure ce que durent les rosses de l’art.
Vivent la caricature, la musique, la vidéo, la bande dessinée, la photographie, l’écriture, etc. qui émaillent tant de faits d’armes et tant de fêtes. Voici où se situent les Jacques Charlier multiples et nombreux ; ceux qui, d’une pirouette, échappent à toute mise en ordre et à toute mise au pas.
On va crier à l’imposture ; tant mieux ! Qu’on crie, cela ne fera pas de mal. Au moins entendrons-nous la voix de ceux qui d’habitude chuchotent dans les cénacles petits où ils se délectent de leurs jugements déjà dictés.
Laurent Busine.
Exposé à la récupération commerciale et médiatique, ce nouveau monde de l’art correspond exactement au paysage artistique que Charlier dépeint avec humour noir dans La Route de l’art. Réalisée en 1978, cette bédé narre l’histoire tragique d’un artiste conceptuel qui, poussé par la radicalité de sa posture antimatérialiste (la grève), commet un suicide artistique pour éviter sa récupération par le 'système'. Accentuée à coups de contre-plongées oppressantes et de contraste noir & blanc, cette perspective cynique désigne aussi le point de fuite (vanishing point) au-delà duquel le sens de l’art, hier ésotérique, se serait inversé pour prendre une valeur définitivement exotérique. Interrogé au début des années 1960 sur les raisons qui l’auraient poussé à cesser de peindre, Marcel Duchamp – premier gréviste de l’art, premier restaurateur ironique aussi de la perspective forcée – déplorait déjà ce basculement de la peinture pour initiés, mystérieuse et spirituelle, vers la peinture pour tous : « Les ésotériques ont laissé le public se faire soi-disant initier. Or, il n’est pas du tout initié. Cet ésotérisme est devenu un exotérisme. Quand vous parlez peinture aujourd’hui, quand vous parlez art en général aujourd’hui, le grand public a son mot à dire, et il le dit. Ajoutez à cela le fait qu’il a apporté son argent et que le commercialisme en art, aujourd’hui, a fait passer la question de l’ésotérisme à l’exotérisme. Alors, l’art est un produit, comme les haricots. On achète de l’art comme on achète du spaghetti. ».
Atteint le jour – mais cette date est-elle repérable ? – où l’art passa du côté des profanes, ce point de fuite, largement dépassé aujourd’hui, par où s’est engouffrée l’histoire moderne marquerait désormais l’an 01 de l’ère dite post-moderne ; non pas l’an 01 de la bédé post-soixante-huitarde de Gébé (11) qui imagina l’utopie d’une grève générale où tout s’arrête, mais celui de la récupération, forcément réactionnaire, de cette contre-culture.
Le scénario de La Route de l’art se termine par un désenchantement semblable, son point de fuite désignant sa principale idée noire : la première « grève sauvage » de l’histoire de l’art finira inévitablement, avec des « rétrospectives bidons », une « vente aux enchères » et une publicité « bien lancée », par réintégrer le système productif. Ce détournement des faits historiques par les médias et le business n’est évidemment pas propre au monde de l’art. Comme Jean Baudrillard l’affirme, au-delà du point de fuite c’est toute l’histoire qui se libère du réel et de la vérité, comme si, passé ce seuil où l’on devient capable de faire dire aux morts ce qu’on veut (12), elle subissait une inversion de sens, une régression. Filant lui aussi la métaphore optique du vanishing point, dans L’illusion de la fin ou la grève des événements, le sociologue développe moins l’idée de la disparition – illusoire – de l’histoire que celle de sa paradoxale réversion : « Segalen dit que la Terre devenue sphère, chaque mouvement qui nous éloigne d’un point commence par là même à nous en rapprocher. Ceci est vrai du temps aussi, ajoute-t-il. Chaque mouvement apparent de l’histoire nous rapproche imperceptiblement de son point antipodique, voire de son point de départ. C’est la fin de la linéarité. Dans cette perspective, le futur n’existe plus. Mais s’il n’y a plus de futur, il n’y a plus de fin non plus. Ce n’est donc même pas la fin de l’histoire. Nous avons affaire à un processus paradoxal de réversion, à un effet réversif de la modernité qui, ayant atteint sa limite spéculative et extrapolée de tous ses développements virtuels, se désintègre en ses éléments simples selon un processus catastrophique de récurrence et de turbulence. » (13).
Dans le même temps qu’il dessine La Route de l’art sur le scénario noir que l’on sait (la récupération de l’art), Charlier fournit également avec Desperados Music (14) le clip musical de cette régression de la modernité par-delà son point de fuite. Tournée sur un plateau télé, la vidéo est l’enregistrement d’un solo lancinant de guitare électrique, disons noisy (façon Glenn Branca (15) ), joué par l’artiste lui-même. Les coups de pédale de réverbération ainsi que les mouvements planants de la caméra autour du musicien produisent une impression d’élasticité voire d’évanouissement temporel composée de moments de dilatation et de contraction, de stagnation aussi. Comme son titre l’indique, cette musique – qualifiée par Charlier de « régressive » – est imprégnée d’une « mélancolie rétrospective » (16) qui correspond typiquement à l’affect dominant de la post-modernité : « Nous sommes tellement habitués, note encore Baudrillard, à nous repasser tous les films, ceux de fiction comme ceux de notre vie, tellement contaminés par la technique rétrospective que nous sommes bien capables, sous le coup du vertige contemporain, de faire redéfiler l’histoire comme un film à l’envers. » (17). Le monde de la publicité ‒ qui intéresse Charlier pour ses paradoxes ‒ a compris tôt le potentiel commercial de la nostalgie ainsi que de ses techniques rétrospectives. Dans un passage désormais culte de Mad Men, série télé que Charlier apprécie pour sa reconstitution méticuleuse du cynisme régnant au cœur d’une agence publicitaire typique du New York des sixties (18), le directeur artistique de la boîte, Don Draper, produit d’ailleurs une belle métaphore de ce pouvoir séductif de la nostalgie. Lors d’une réunion où il doit convaincre les responsables de Kodak de rebaptiser « Carrousel » leur nouveau modèle de projecteur de diapositives, le publicitaire vise juste :
« La nostalgie.
C'est subtil, mais très puissant…
Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement une blessure ancienne qui fait toujours mal.
C'est un pincement au cœur, teinté de regrets, et bien plus puissant qu'un simple souvenir.
Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps.
D'une pression on recule, on avance.
Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver.
Cette chose n'est pas une roue.
C'est un carrousel.
Grâce à lui on voyage comme un enfant sur un manège.
On tourne, et on tourne, et on retourne au point de départ, ce lieu magique où on se sait aimé. » (19)
Toute la peinture de Charlier rend compte de ce goût mélancolique de notre époque pour le déjà-vu, car tous ses tableaux sont des reprises de vieux tubes de l’histoire de l’art, et tout son œuvre peint, une sorte de juke-box grâce auquel nous sautons d’un morceau choisi à l’autre, entraînés dans la ronde nostalgique de son « éclectisme radical ». Peinture pour tous, au Grand-Hornu, n’échappe pas à ce principe de carrousel temporel qui revisite les styles de l’art moderne le long de plusieurs ensembles de pastiches : expressionnisme abstrait (« Peintures volcans »), futurisme italien (Peintures italiennes (20) ), post-impressionnisme (Les quatre saisons), abstraction géométrique (Peintures fractales). En faussaire et caricaturiste, Charlier s’amuse avec une exposition où la production virtuose de faux vieux côtoie l’imitation potache de vrais gimmicks ; du toc et des tics, quoi ! Avec sa chambre d’Ames (21) ou sa galerie colorée de Fontana, c’est encore son insistance à démontrer que l’histoire de l’art repose sur une illusion d’optique, de l’ordre de la perspective forcée ; façon de nous faire comprendre, par exemple, qu’un artiste n’est pas grand parce que sa cote est haute sur le marché ou sa popularité élevée dans les médias. C’est ce mirage, cette manipulation, voire ce complot diront certains détracteurs de l’art contemporain (22), que Charlier s’applique, par l’image et la parole, tel Platon avec le mythe de la caverne, à déconstruire pour (le bien de) tous.