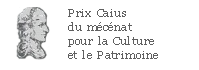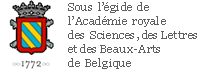C'est très simple...
Il suffit de poser votre candidature ici.
Il suffit de poser votre candidature ici.
Vous pouvez soutenir le projet Koregos de plusieurs façons. Cliquez ici pour tout savoir.
Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny
 « Le châssis, la toile ne sont que l’équivalent de l’arc pour le tireur. Ce qui compte c’est l’irradiation immatérielle de la composition ».
« Le châssis, la toile ne sont que l’équivalent de l’arc pour le tireur. Ce qui compte c’est l’irradiation immatérielle de la composition ».
« L’algèbre des structures et la magie des couleurs m’aident à percer le monde des apparences, à entrouvrir une fenêtre même étroite sur ‘l’autre côté’. […] La création est, pour moi, une dure et passionnante ascension vers une certaine idée de la perfection1 ».
De 1969 à 1973, Guy de Lussigny (Cambrai, 1929-Paris, 2001) réalise des peintures résolument abstraites géométriques sur bois ou sur isorel pour lesquelles il introduit la feuille d’or ou d’argent comme matière picturale à part entière. Il exécute parallèlement de nombreuses gouaches – certaines préparatoires aux peintures - dorées ou argentées. Témoignant d’un questionnement du geste pictural en pleine période de recherche, ce travail n’est pas isolé des préoccupations artistiques de cette deuxième moitié du XXe siècle : il vient à un moment où une forme de ‘retour à l’or’ se constate à partir des années 50. Intitulé Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny, l’accrochage au musée des beaux-arts de Cambrai jusqu’au 27 mars réunit quelques 35 œuvres de Lussigny. C’est l’occasion pour la structure muséale de poursuivre son travail de recherches autour de l’artiste qui reste encore à ce jour peu étudié.
Si les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle ne semblent pas s’y intéresser, l’or comme matériau de l’œuvre réapparaît au cours du milieu du XXe siècle, les artistes l’incorporent dans leurs travaux pour des raisons multiples, en premier lieu pour ses qualités symboliques et/ou physiques. C’est au début des années 50 que l’or – mais aussi l’argent – est réintroduit, de manière ponctuelle pour quelques œuvres seulement ou de façon régulière, par des artistes aussi divers que Robert Rauschenberg (Gold Painting dès 1953), Anna-Eva Bergman (dès la fin des années 40), Remo Bianco (série des Tableaux dorés à partir de 1957), Georges Mathieu (trois toiles abstraites en février 1957) et bien sûr Yves Klein (Monogolds à partir de 1959). Tout à la fois matériau, couleur, lumière et valeur, l’or réapparaît par le biais des médiums traditionnels de l’art (peinture, sculpture) envisagés dans ce contexte artistique renouvelé mais également par la convocation de dispositifs artistiques consacrés dans les années 60-70 telles la performance ou l’installation. Comme le note Magali Abad, l’usage de l’or procède d’un « désir ou d’une nécessité d’élection, de glissement vers un niveau de perception plus intellectuel, signe d’une modification du registre de représentation ; car l’or ne ‘représente’ pas, il qualifie2 ».
C’est dans ce contexte commun que l’artiste Guy de Lussigny décide, en 1969, d’intégrer la feuille d’or et d’argent dans son travail d’abstraction géométrique alors en pleine recherche. En effet, l’artiste expérimente beaucoup à cette époque – formats des œuvres, motifs géométriques avec la persistance du cercle, couleurs, compositions - avant l’année 1974 qui verra la définition de son langage artistique exclusivement formalisé autour du carré. L’influence de l’art italien de la Renaissance est à considérer dans ce retour à l’or : la Toscane et l’art siennois des XIIIe et XIVe siècle accompagnent l’artiste. En effet, l’Italie et sa grande Peinture, qu’elle représente pour cet artiste autodidacte, ne cesseront de l’influencer tout au long de son parcours artistique. L’œuvre Hommage à Duccio (1959, collection mba de Cambrai), présentée dans l’accrochage en guise d’introduction, témoigne de cet attrait à plusieurs égards : dans l’usage des couleurs - les orangés, mauves ou roses éloignés des couleurs primaires qui caractérisent souvent l’abstraction géométrique - puisées ici dans les œuvres mêmes de Duccio ; la mise au carreau préparatoire à la composition finale ; le sujet de la Madone à l’Enfant soudainement épuré par les formes abstraites. A cette époque, Lussigny évolue encore entre figuration et abstraction, suite à des rencontres artistiques déterminantes – Gino Severini en 1955 et Auguste Herbin en 1956 – qui l’encouragent dans sa voie de peintre abstrait.
Lussigny ne tardera pas à se confronter à la technique si particulière de la feuille d’or. En 1969, le passage est réalisé, quatre œuvres en témoignent dans cette exposition. A ce moment-là, Guy de Lussigny – qui vit à Paris depuis 1967 – développe une œuvre sur support bois intégrant la feuille d’or ou d’argent à des motifs géométriques peints à l’acrylique : par leur juxtaposition, l’or ou l’argent viennent ainsi illuminer si ce n’est animer les cercles, carrés ou rectangles qui font désormais partie de son vocabulaire plastique. Ces œuvres peuvent s’apparenter à l’art cinétique qui se développe alors et que Lussigny a pu entrevoir plusieurs aspects par le biais entre autres de ses fonctions de directeur-collaborateur à la galerie Denise René connue pour son engagement dans l’art abstrait géométrique. Chez Lussigny, l’usage de l’or est de deux ordres. D’une part, il s’agit de renouer et de s’inscrire dans une certaine tradition artisanale du geste pictural, par la maîtrise de la technique, fondamentale pour l’artiste. D’autre part, l’artiste considère pleinement l’or tout à la fois comme lumière et couleur, ‘couleur-matière’ par excellence, qui, associé à des couleurs multiples engendrant les équivalences or=jaune et argent=blanc, crée « des constructions purement intellectuelles, mais jamais gratuites et correspondant à une nécessité intérieure2 ».
L’année 1973 est la dernière étape avant le basculement définitif du vocabulaire de l’artiste vers une rigueur affirmée par l’usage exclusif du carré. Les trois œuvres exposées désormais sur isorel témoignent de ce changement : abandon du cercle pour le rectangle et le carré, choix progressif du format carré pour le support, stabilité de la composition par un agencement rigoureux des motifs géométriques. Apparaît également à cette époque le système de référencement que l’artiste met en place pour le classement de ses œuvres : désormais, toutes ses œuvres seront ‘sans titre’ et accompagnées d’un numéro à trois chiffres, d’une lettre et d’un chiffre romain notifiés sur l’œuvre. Cette mise en inventaire des œuvres se fera également par le biais de fiches classées dans des casiers de métal, source d’information essentielle pour l’historien de l’art dans sa recherche du catalogue raisonné de l’artiste.
Les années 70 sont celles de la maturité pour Lussigny et les œuvres présentées nous invitent à percevoir ce changement. Ces dernières peintures à la feuille d’or sont désormais soumises au langage autoritaire de l’abstraction pure que l’artiste s’est défini, elles sont encore à cette croisée des chemins où une forme d’art immémoriale (l’icône) dialogue avec la modernité, incitant désormais le spectateur à penser ce qu’il voit. Comme Lussigny le note en 1995 : « Ma conviction est évidemment que le sens de l’art est ailleurs. Si l’intuition doit en cette matière rester maîtresse du jeu, il n’en est pas moins indispensable de s’imposer des règles comme bases de travail, à partir desquelles, en dehors de tout système, seront canalisées les sensations proprement picturales qu’il s’agit de transmettre et c’est à l’artiste de se forger ces règles auxquelles il sera tenu ensuite d’obéir face à lui-même. C’est ainsi que si certaines théories (Mondrian, Klee, Herbin Albers) m’ont aidé dans mes premiers essais, il m’est apparu assez vite qu’aucune loi ne pouvait s’imposer totalement, que j’avais à trouver seul le chemin qui devait devenir le mien, c’est-à-dire la recherche de l’équilibre mystérieux qui sous-tend les rapports entre la subjectivité et le concret… J’ai ressenti fortement la nécessité de la prééminence de la spiritualité sur l’automatisme systématique […]4 ».
Enfin, l’accrochage au musée se termine par la présentation du travail sur papier de Lussigny, quelques 25 gouaches dorées ou argentées sont exposées. Toutes sont datées entre 1968 et 1974 et sont disposées dans l’espace du Cabinet d’arts graphiques de telle façon qu’elles forment mur devant le visiteur. Cette présentation permet sans conteste de témoigner d’un seul coup d’œil de l’évolution stylistique sur cette période courte de 6 années tout en mettant en évidence une grande cohérence dans le travail.
L’œuvre de Guy de Lussigny, artiste natif de Cambrai, est bien représentée au sein des collections du musée des beaux-arts. Le musée possède ainsi un fonds quasi exhaustif retraçant son parcours artistique, fonds qui a été construit grâce aux dons réguliers d’André Le Bozec, collectionneur et exécuteur testamentaire de l’artiste. Après une exposition rétrospective en 2011 qui a donné lieu à l’édition d’un catalogue et à une seconde donation, cet accrochage dédié à la période dorée de l’artiste est l’occasion d’approfondir l’étude. De plus, alors que l’art récent donne à voir une résurgence des formes abstraites et des matériaux précieux tel l’or que viennent confirmer de récentes expositions et publications5, cette mise en lumière et en histoire de ce travail de Lussigny trouve toute sa cohérence et sa pertinence aujourd’hui.
Alice Cornier, directrice du musée des beaux-arts de Cambrai
1 Guy de Lussigny, La traversée des apparences, éditions OCD, Paris, 1982
2 Magali Abad, Les noces sacrées de l’or et du bleu. Pratique picturale et portée symbolique, Primaires n°171, Centre français de la couleur, juillet 2010. Consultable en ligne : www.magaliabad.com
3 Guy de Lussigny, op cit
4 Guy de Lussigny, juillet 1995, cité dans Marie Lapalus, « Essais comparés pour un double portrait ou la peinture et l’écriture comme autoportrait », in Lussigny. Rétrospective 1952-2001. La couleur à travers le temps, catalogue de l’exposition au musée de Cambrai, 2010, pg 17
5 On citera à titre d’exemple les expositions Aurum. L'or dans l'art contemporain au CentrePasquArt de Bienne (CH) en 2008, Gold au Belvédère à Vienne (A) en 2012 ou Gold au Bass Museum de Miami (US) en 2014 ainsi qu’au Neuberger Museum of Art, New York (US) en 2015. Parmi qq ouvrages récents : L’or dans l’art contemporain sous la direction d’Anne-Marie Charbonneaux chez Flammarion en 2010 ou Les variations de l'or dans l'art contemporain de Frédérique Lecerf aux éditions universitaires européennes en 2015



Actualités
22 Février 2016

 « Le châssis, la toile ne sont que l’équivalent de l’arc pour le tireur. Ce qui compte c’est l’irradiation immatérielle de la composition ».
« Le châssis, la toile ne sont que l’équivalent de l’arc pour le tireur. Ce qui compte c’est l’irradiation immatérielle de la composition ».« L’algèbre des structures et la magie des couleurs m’aident à percer le monde des apparences, à entrouvrir une fenêtre même étroite sur ‘l’autre côté’. […] La création est, pour moi, une dure et passionnante ascension vers une certaine idée de la perfection1 ».
De 1969 à 1973, Guy de Lussigny (Cambrai, 1929-Paris, 2001) réalise des peintures résolument abstraites géométriques sur bois ou sur isorel pour lesquelles il introduit la feuille d’or ou d’argent comme matière picturale à part entière. Il exécute parallèlement de nombreuses gouaches – certaines préparatoires aux peintures - dorées ou argentées. Témoignant d’un questionnement du geste pictural en pleine période de recherche, ce travail n’est pas isolé des préoccupations artistiques de cette deuxième moitié du XXe siècle : il vient à un moment où une forme de ‘retour à l’or’ se constate à partir des années 50. Intitulé Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny, l’accrochage au musée des beaux-arts de Cambrai jusqu’au 27 mars réunit quelques 35 œuvres de Lussigny. C’est l’occasion pour la structure muséale de poursuivre son travail de recherches autour de l’artiste qui reste encore à ce jour peu étudié.
Si les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle ne semblent pas s’y intéresser, l’or comme matériau de l’œuvre réapparaît au cours du milieu du XXe siècle, les artistes l’incorporent dans leurs travaux pour des raisons multiples, en premier lieu pour ses qualités symboliques et/ou physiques. C’est au début des années 50 que l’or – mais aussi l’argent – est réintroduit, de manière ponctuelle pour quelques œuvres seulement ou de façon régulière, par des artistes aussi divers que Robert Rauschenberg (Gold Painting dès 1953), Anna-Eva Bergman (dès la fin des années 40), Remo Bianco (série des Tableaux dorés à partir de 1957), Georges Mathieu (trois toiles abstraites en février 1957) et bien sûr Yves Klein (Monogolds à partir de 1959). Tout à la fois matériau, couleur, lumière et valeur, l’or réapparaît par le biais des médiums traditionnels de l’art (peinture, sculpture) envisagés dans ce contexte artistique renouvelé mais également par la convocation de dispositifs artistiques consacrés dans les années 60-70 telles la performance ou l’installation. Comme le note Magali Abad, l’usage de l’or procède d’un « désir ou d’une nécessité d’élection, de glissement vers un niveau de perception plus intellectuel, signe d’une modification du registre de représentation ; car l’or ne ‘représente’ pas, il qualifie2 ».
C’est dans ce contexte commun que l’artiste Guy de Lussigny décide, en 1969, d’intégrer la feuille d’or et d’argent dans son travail d’abstraction géométrique alors en pleine recherche. En effet, l’artiste expérimente beaucoup à cette époque – formats des œuvres, motifs géométriques avec la persistance du cercle, couleurs, compositions - avant l’année 1974 qui verra la définition de son langage artistique exclusivement formalisé autour du carré. L’influence de l’art italien de la Renaissance est à considérer dans ce retour à l’or : la Toscane et l’art siennois des XIIIe et XIVe siècle accompagnent l’artiste. En effet, l’Italie et sa grande Peinture, qu’elle représente pour cet artiste autodidacte, ne cesseront de l’influencer tout au long de son parcours artistique. L’œuvre Hommage à Duccio (1959, collection mba de Cambrai), présentée dans l’accrochage en guise d’introduction, témoigne de cet attrait à plusieurs égards : dans l’usage des couleurs - les orangés, mauves ou roses éloignés des couleurs primaires qui caractérisent souvent l’abstraction géométrique - puisées ici dans les œuvres mêmes de Duccio ; la mise au carreau préparatoire à la composition finale ; le sujet de la Madone à l’Enfant soudainement épuré par les formes abstraites. A cette époque, Lussigny évolue encore entre figuration et abstraction, suite à des rencontres artistiques déterminantes – Gino Severini en 1955 et Auguste Herbin en 1956 – qui l’encouragent dans sa voie de peintre abstrait.
Lussigny ne tardera pas à se confronter à la technique si particulière de la feuille d’or. En 1969, le passage est réalisé, quatre œuvres en témoignent dans cette exposition. A ce moment-là, Guy de Lussigny – qui vit à Paris depuis 1967 – développe une œuvre sur support bois intégrant la feuille d’or ou d’argent à des motifs géométriques peints à l’acrylique : par leur juxtaposition, l’or ou l’argent viennent ainsi illuminer si ce n’est animer les cercles, carrés ou rectangles qui font désormais partie de son vocabulaire plastique. Ces œuvres peuvent s’apparenter à l’art cinétique qui se développe alors et que Lussigny a pu entrevoir plusieurs aspects par le biais entre autres de ses fonctions de directeur-collaborateur à la galerie Denise René connue pour son engagement dans l’art abstrait géométrique. Chez Lussigny, l’usage de l’or est de deux ordres. D’une part, il s’agit de renouer et de s’inscrire dans une certaine tradition artisanale du geste pictural, par la maîtrise de la technique, fondamentale pour l’artiste. D’autre part, l’artiste considère pleinement l’or tout à la fois comme lumière et couleur, ‘couleur-matière’ par excellence, qui, associé à des couleurs multiples engendrant les équivalences or=jaune et argent=blanc, crée « des constructions purement intellectuelles, mais jamais gratuites et correspondant à une nécessité intérieure2 ».
L’année 1973 est la dernière étape avant le basculement définitif du vocabulaire de l’artiste vers une rigueur affirmée par l’usage exclusif du carré. Les trois œuvres exposées désormais sur isorel témoignent de ce changement : abandon du cercle pour le rectangle et le carré, choix progressif du format carré pour le support, stabilité de la composition par un agencement rigoureux des motifs géométriques. Apparaît également à cette époque le système de référencement que l’artiste met en place pour le classement de ses œuvres : désormais, toutes ses œuvres seront ‘sans titre’ et accompagnées d’un numéro à trois chiffres, d’une lettre et d’un chiffre romain notifiés sur l’œuvre. Cette mise en inventaire des œuvres se fera également par le biais de fiches classées dans des casiers de métal, source d’information essentielle pour l’historien de l’art dans sa recherche du catalogue raisonné de l’artiste.
Les années 70 sont celles de la maturité pour Lussigny et les œuvres présentées nous invitent à percevoir ce changement. Ces dernières peintures à la feuille d’or sont désormais soumises au langage autoritaire de l’abstraction pure que l’artiste s’est défini, elles sont encore à cette croisée des chemins où une forme d’art immémoriale (l’icône) dialogue avec la modernité, incitant désormais le spectateur à penser ce qu’il voit. Comme Lussigny le note en 1995 : « Ma conviction est évidemment que le sens de l’art est ailleurs. Si l’intuition doit en cette matière rester maîtresse du jeu, il n’en est pas moins indispensable de s’imposer des règles comme bases de travail, à partir desquelles, en dehors de tout système, seront canalisées les sensations proprement picturales qu’il s’agit de transmettre et c’est à l’artiste de se forger ces règles auxquelles il sera tenu ensuite d’obéir face à lui-même. C’est ainsi que si certaines théories (Mondrian, Klee, Herbin Albers) m’ont aidé dans mes premiers essais, il m’est apparu assez vite qu’aucune loi ne pouvait s’imposer totalement, que j’avais à trouver seul le chemin qui devait devenir le mien, c’est-à-dire la recherche de l’équilibre mystérieux qui sous-tend les rapports entre la subjectivité et le concret… J’ai ressenti fortement la nécessité de la prééminence de la spiritualité sur l’automatisme systématique […]4 ».
Enfin, l’accrochage au musée se termine par la présentation du travail sur papier de Lussigny, quelques 25 gouaches dorées ou argentées sont exposées. Toutes sont datées entre 1968 et 1974 et sont disposées dans l’espace du Cabinet d’arts graphiques de telle façon qu’elles forment mur devant le visiteur. Cette présentation permet sans conteste de témoigner d’un seul coup d’œil de l’évolution stylistique sur cette période courte de 6 années tout en mettant en évidence une grande cohérence dans le travail.
L’œuvre de Guy de Lussigny, artiste natif de Cambrai, est bien représentée au sein des collections du musée des beaux-arts. Le musée possède ainsi un fonds quasi exhaustif retraçant son parcours artistique, fonds qui a été construit grâce aux dons réguliers d’André Le Bozec, collectionneur et exécuteur testamentaire de l’artiste. Après une exposition rétrospective en 2011 qui a donné lieu à l’édition d’un catalogue et à une seconde donation, cet accrochage dédié à la période dorée de l’artiste est l’occasion d’approfondir l’étude. De plus, alors que l’art récent donne à voir une résurgence des formes abstraites et des matériaux précieux tel l’or que viennent confirmer de récentes expositions et publications5, cette mise en lumière et en histoire de ce travail de Lussigny trouve toute sa cohérence et sa pertinence aujourd’hui.
Alice Cornier, directrice du musée des beaux-arts de Cambrai
1 Guy de Lussigny, La traversée des apparences, éditions OCD, Paris, 1982
2 Magali Abad, Les noces sacrées de l’or et du bleu. Pratique picturale et portée symbolique, Primaires n°171, Centre français de la couleur, juillet 2010. Consultable en ligne : www.magaliabad.com
3 Guy de Lussigny, op cit
4 Guy de Lussigny, juillet 1995, cité dans Marie Lapalus, « Essais comparés pour un double portrait ou la peinture et l’écriture comme autoportrait », in Lussigny. Rétrospective 1952-2001. La couleur à travers le temps, catalogue de l’exposition au musée de Cambrai, 2010, pg 17
5 On citera à titre d’exemple les expositions Aurum. L'or dans l'art contemporain au CentrePasquArt de Bienne (CH) en 2008, Gold au Belvédère à Vienne (A) en 2012 ou Gold au Bass Museum de Miami (US) en 2014 ainsi qu’au Neuberger Museum of Art, New York (US) en 2015. Parmi qq ouvrages récents : L’or dans l’art contemporain sous la direction d’Anne-Marie Charbonneaux chez Flammarion en 2010 ou Les variations de l'or dans l'art contemporain de Frédérique Lecerf aux éditions universitaires européennes en 2015
Informations pratiques

Lieu : Musée des Beaux-Arts
15 rue de l’Epée, 59400 Cambrai (France)
Dates : Jusqu’au 27 mars 2016
Horaires : Accessible du mercredi au dimanche de 10 à 12h00 et de 14 à 18h00
Lien : www.villedecambrai.com
15 rue de l’Epée, 59400 Cambrai (France)
Dates : Jusqu’au 27 mars 2016
Horaires : Accessible du mercredi au dimanche de 10 à 12h00 et de 14 à 18h00
Lien : www.villedecambrai.com
Galerie

Galerie

| 2 images | Diaporama |
FRANCAIS - ENGLISH
Connexion
Lettre d'information