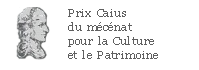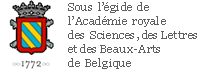C'est très simple...
Il suffit de poser votre candidature ici.
Il suffit de poser votre candidature ici.
Vous pouvez soutenir le projet Koregos de plusieurs façons. Cliquez ici pour tout savoir.
Décès du professeur Paul Philippot
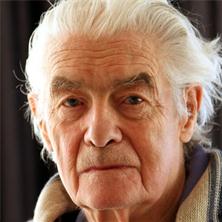 Paul Philippot professeur
Paul Philippot professeur
« Pour tous ceux qui eurent la chance d’en bénéficier, l’enseignement de Paul Philippot ne fut pas seulement l’occasion d’une rencontre prolongée avec le savoir ample, profond et varié d’un véritable humaniste. Il fut aussi une invitation permanente à assumer une position d’autonomie active vis-à-vis des conformismes pesant sur la Kunstwissenschaft, conformismes liés à la fois aux formes de discours prescrites par l’institution universitaire et à la conception courante du savoir scientifique, mais particulièrement inadéquats dans le cas de la discipline qui est la nôtre. Sans bien sûr abandonner aucune des exigences de rigueur et de probité constitutives du discours scientifique traditionnel, sans davantage s’attacher le moins du monde aux signes extérieurs de la contestation, le travail pédagogique accompli par Paul Philippot à l’Université Libre de Bruxelles, fut celui d’une véritable libération.
Nous aimerions en rappeler quelques aspects.
L’un des rapports les plus sensibles de cet enseignement est sans doute de nous avoir largement affranchis d’une tendance au refoulement de la subjectivité, qui domine le discours sur la culture du passé. De façon très générale en effet, le savoir universitaire, pris comme ensemble indissociable de méthodes et de valeurs, détermine la subjectivité du regard comme un élément parasite, vecteur d’erreur et d’obscurité : c’est la puissance aveugle et perturbatrice de l’irréfléchi, du pur caprice inconsistant, qui vient toujours troubler la procession du savoir. S’il est vrai qu’aujourd’hui les déclarations de principe vont souvent à l’encontre de cette préconception elle n’en demeura pas moins, consciemment ou non, très active dans la pratique de l’historien d’art. Or, cette hostilité plus ou moins tacite vis-à-vis de la subjectivité n’a pas pour seule conséquence malheureuse d’appauvrir la notion même d’objectivité, laquelle se voit réduite au statut d’une vertu plutôt mesquine, comme si la rigueur scientifique n’était au fond que l’art purement réactif d’éviter les sollicitations frivoles. Elle n’a pas non plus pour seul effet néfaste de favoriser par défaut le retour d’une subjectivité devenue effectivement triviale du fait de n’avoir pas été assumée, travaillée, éduquée dans la perspective du savoir. Plus grave encore, la pratique scientifique de l’historien de d’art se voit ainsi privée d’outils de connaissance parfaitement adaptés au champ spécifique qui est le sien. Contre cette propension, donc, l’enseignement de Paul Philippot a su faire valoir les droits du regard subjectif considéré comme instance pleinement positive du savoir scientifique sur l’art.
Dans ses leçons sur l’histoire de la peinture, Paul Philippot se référait volontiers à l’expérience personnelle immédiate qu’il avait eue devant les œuvres originales, à l’impact décisif de cette expérience sur son questionnement. Introduisant son cours sur le Caravagisme, il racontait qu’il avait eu un jour, dans la « chapelle Contarelli » à Rome, l’intuition subite qu’il y avait bien plus que la recette du clair-obscur, mais une vraie problématique de style pictural ; et qu’ « au fond, le Caravage, c’était en quelque sorte le Rembrandt italien. Jusqu’ici, ajoutait-il, je ne m’étais jamais vraiment intéressé à ce peintre, mais à partir de ce moment, j’eus le désir de savoir quelle était exactement la situation présente du discours critique sur le Caravage ». Paul Philippot affirmait ainsi d’entrée de jeu que, pour lui, le point de départ d’une recherche pouvait fort bien se situer dans la sphère intime des associations spontanées suscitées par l’œuvre, et non tout d’abord dans l’espace public de la littérature d’histoire de l’art et de ses interrogations traditionnelles. Pour nous, un tel aveu liminaire signifiait non seulement que la subjectivité avait sa place dans la « Kunstwissenschaft », mais en outre qu’elle pouvait même constituer un outil cognitif de premier ordre. Dans son cours d’esthétique, Paul Philippot proposait d’ailleurs de concevoir l’histoire de l’art comme une critique d’art qui se développe en termes de conscience historique, critique où l’appréciation de la valeur esthétique ne peut par conséquent jamais disparaître dans un relativisme pur et simple.
Bien entendu, il ne s’agit pas pour autant de réduire la démarche critique à ce seul moment de l’appréhension subjective immédiate, mais bien de l’utiliser au profit de l’interprétation critico-historique la plus rigoureuse. C’est dire que l’intuition esthétique directe, procédant du contact immédiat avec l’œuvre, ne livre ses richesses que si elle vient jouer dans le système complexe et bien architecturé des médiations théoriques. Ce système est formé, d’une part, de la masse des connaissances factuelles touchant non seulement les œuvres du musée imaginaire, prises dans leurs déterminations géographiques et chronologiques, mais aussi leur fortune critique, toujours indissociable du corpus lui-même. Il se compose d’autre part des concepts qui permettent de s’orienter dans ce corpus selon une perspective déterminée, en fonction d’un projet interprétatif lié de la façon la plus étroite possible à notre situation culturelle fondamentale. Ce qu’il faut viser toujours, c’est donc l’établissement d’une sorte de réseau d’échanges à double sens entre le contact immédiat avec l’œuvre et la réflexion théorique proprement dite, laquelle a charge de manœuvrer ces médiations complexes que sont les concepts et les connaissances d’érudition. Outre l’acquisition d’une maîtrise du côté « objectif », une telle démarche implique par conséquent la nécessité d’un travail permanent sur la subjectivité intuitive, afin précisément de la rendre apte à dialoguer avec les médiations théoriques.
L’enseignement de Paul Philippot s’est donné comme une invitation toujours renouvelée à nous livrer sans compter à cet entraînement du regard connaissant. Une subjectivité formée par un tel travail n’aura donc rien à voir avec l’insupportable petit « moi » qui, en art surtout, se persuade toujours qu’il a pleine voix au chapitre. Cette subjectivité-là, tout homme de science a raison de l’écarter avec agacement. Paul Philippot a fait mieux que cela. Sachant tourner l’agacement en une ironie intellectuelle légère et incisive, il l’exerçait au profit d’une réflexion supplémentaire sur la formation du regard. Quelque fois dans ses cours, le plus souvent en marge de ceux-ci, lors de contacts informels avec les étudiants, il se plaisait à indiquer les exemples de subjectivisme sauvage à ne pas suivre, et ne se privait pas d’analyser les vices du sujet trivial et leur fonctionnement – non sans jubilation, mais toujours aux fins positives d’une pédagogie de dissuasion des plus efficaces…
Mais là ne se borne pas l’apport libérateur de son enseignement. Il s’est aussi exercé sur l’aspect complémentaire de la subjectivité bien comprise, par l’attention et le goût portés aux aspects proprement philosophiques de la « Kunstwissenschaft ». L’éducation de l’intuition peut être l’essentiel sans l’optique de la « Kennerschaft » - bien que, même dans ce cas, l’on ne puisse jamais se passer tout à fait de concepts bien ancrés. Mais elle s’avère forcément insuffisante pour un savoir fondamental. Celui-ci demande encore le développement de concepts généraux fondés et liés entre eux, ainsi que l’appréhension des enjeux ultimes, jamais évidents, de la pratique même du savoir scientifique considéré. Sur ce plan essentiel, la pédagogie de Paul Philippot s’est également avérée des plus fécondes : elle n’a cessé de favoriser la créativité conceptuelle dans les cadres de l’histoire de l’art, ainsi que la réflexion de fond sur les aspects les plus généraux des problèmes posés par celle-ci, à la fois comme science particulière et par rapport à l’expérience culturelle en général.
Une lecture assidue et toujours originale des grands philosophes avait ouvert à Paul Philippot des accès précieux aux textes fondateurs de notre discipline, tels l’ « Esthétique » de Hegel. Elle lui a également inspiré une réflexion personnelle sur ses fondements actuels, en particulier dans le sillage de la phénoménologie. Cela aussi, il nous l’a fait partager, ne serait-ce qu’en diffusant dans son cours d’esthétique les théories de Cesare Brandi – lesquelles seraient probablement restées inconnues dans le domaine francophone s’il n’avait su nous en montrer la fécondité particulière. Dès lors, si les historiens d’art formés par Paul Philippot ont eu l’occasion de se trouver supérieurement « armés » sur le plan des concepts, ils se sont surtout vu offrir la possibilité d’une rare liberté dans l’exercice de leur savoir. Car en nous communiquant une expérience approfondie des questions théoriques les plus lointaines de la réflexion sur l’histoire de l’art, son enseignement nous a invités à revoir et à réinventer toujours les fondements et les enjeux de notre discipline, ainsi qu’à appréhender toute l’étendue et toute la profondeur de ses possibilités. C’est ainsi que Paul Philippot n’a jamais hésité à encourager le questionnement historico-esthétique sur les objets les plus divers de l’histoire des formes. Nombreux sont les contemporanéistes à avoir bénéficié de l’ouverture et de l’acuité exceptionnelles du regard porté sur l’art moderne, y compris en ses avancées les plus radicales, par ce grand spécialiste de l’art ancien. Mais cette aptitude à élargir le champ de la réflexion esthétique s’est aussi exercée dans d’autres domaines que ceux de la culture occidentale et à d’autres niveaux que celui de la sphère artistique proprement dite. Nous avons, par exemple, beaucoup appris de ces anecdotes de voyage où il s’entend si bien à faire apparaître comment les différences historiques et culturelles profondes se manifestent de façon concrète dans la dimension du quotidien, des mœurs ou des formes psychologiques courantes. A un autre niveau encore, les systèmes philosophiques eux-mêmes n’ont-ils pas leurs rythmes et leurs formes ?
Pourtant, si l’on peut dire que Paul Philippot a libéré le champ d’exercice de la « Kunstwissenschaft » en l’ouvrant souvent bien au-delà des limites du musée imaginaire, aux dimensions d’une sorte d’esthétique généralisée, il importe de rappeler aussi combien il a su nous rendre attentifs à éviter que cette extension ne débouche sur une double dissolution des méthodes et de l’objet spécifiques de notre science. L’un des soucis les plus constants qu’il ait inculqués, peut-être son souci central, consiste à refuser toute abdication de la question de l’art comme histoire de styles. Car une telle dissolution est le principal danger qui la guette, à une époque où elle ne peut certes plus ignorer la pertinence fondamentale des créations contemporaines, inspirées en grande partie par la critique du primat de l’exigence stylistique, pas plus qu’elle ne peut se passer d’échanges méthodologiques poussés avec d’autres disciplines du savoir scientifique. La démarche qui paraît avoir toujours guidé la pensée de Paul Philippot reste à cet égard d’une justesse particulière, et ses élèves n’ont pas fini de la méditer. Comme une sorte d’écologie de la méthode, elle revient en somme à reconnaître la valeur et la richesse des savoirs qui nous ont précédés sur notre propre terrain et l’ont pour ainsi dire ouvert à notre liberté. Elle revient à faire fond sur le legs méthodologique de la « Kunstwissenschaft », dont la tradition remonte au moins à Wölfflin, et à considérer ce legs comme une ferme base de départ qui demeure toujours le foyer d’orientation des réformes ou dérives critiques, parfois fort lointaines, qu’imposent les déterminations de notre époque. Si l’on ne saurait nier que l’art contemporain exige entre autres la critique de la notion de style, toute-puissante aux aurores de la « Kunstwissenschaft », cela n’implique nullement que l’on puisse la répudier dans l’étude des arts anciens. Bien plus, l’approche de l’art contemporain lui-même, dont la spécificité n’apparaît dans sa profondeur que sur le fond de perspective historique, demande plutôt que cette notion soit conservée et repensée, fût-ce en négatif, comme un concept opératoire toujours prégnant.
Jamais donc, Paul Philippot n’aura contribué à figer l’histoire de l’art sur son acquis. Mais jamais non plus on ne l’a pris à répandre le sentiment décourageant d’une déperdition au niveau de la spécificité de notre discipline et d’un effritement de son ancrage dans une tradition de pensée. Il sut au contraire nous prémunir des égarements trop faciles au fil desquels les méthodes et l’objet central de l’histoire de l’art se décomposent et se confondent. Cette souple vigilance, fondée sur la conscience d’un balancement nécessaire de la méthode entre le centre et les décentrements, constitue au demeurant le principe de l’originalité réelle de ses contacts avec les autres disciplines, rapportant leurs méthodes et leurs questions à la pratique et aux problèmes du regard historico-esthétique comme tel.
Nul doute que l’ampleur théorique de l’histoire de l’art pratiquée par Paul Philippot soit précisément ce qui en fait un directeur de recherches des plus ouverts, même aux projets très éloignés de son « domaine ». Tant au niveau d’une thèse de doctorat que pour un mémoire de licence, ceux qu’il a aidés n’ont pu manquer d’être frappés par la rapidité et la vigueur avec laquelle il saisit une problématique relevante, en cerne l’enjeu et devance la réflexion, soutenant ainsi les mouvements de la recherche. Et s’il est vrai que le désir d’étonner le maître compte pour beaucoup dans ce qui fait avancer l’élève, d’emblée la barre se plaçait haut de ce point de vue. Est-ce encore le fait conscient de sa pédagogie si, sans jamais marquer la distance du maître à l’élève, bien au contraire, Paul Philippot a souvent produit l’espèce de choc en retour par lequel l’étonnement revenait aussitôt frapper qui s’adressait à lui ?
Enfin, son enseignement eut encore un effet libérateur par rapport aux conditionnements qui peuvent résulter de notre appartenance à un espace linguistique et culturel déterminé. L’ « italianisme » de Paul Philippot fut pour nous la preuve vécue qu’il était possible, pour un Belge francophone, de participer pleinement d’une tradition théorique et critique autre que la tradition française, et de s’insérer par choix délibéré dans un espace de pensée et de discussion auquel on n’appartient ni par la langue ni par la formation reçue. Aucun des autres aspects mis en évidence ne peut d’ailleurs se dissocier de cet enrichissement culturel considérable qui procéda d’une immersion active dans le milieu italien. Celle-ci fut déterminante quant à la conscience des ressources de l’intuition subjective, pour une très large part l’apanage de la critique italienne. Et les élaborations théoriques de Croce, d’Argan ou de Brandi furent autant d’apports essentiels pour l’ouverture théorique de l’histoire de l’art précisément conçue comme discipline du regard historique sur les œuvres elles-mêmes ; autant de passerelles à double sens pour cheminer entre le regard et le concept, entre « Kunstwissenschaft » et philosophie.
A travers ces quelques brèves remarques, il apparaît combien l’enseignement dispensé par Paul Philippot fut loin de se borner à la transmission d’un ensemble de connaissances. C’est une certaine conception vécue du « métier » d’historien d’art que nous lui devons, l’exemple d’un style de savoir. Ce style, nous le voyons porté surtout par une manière de traduire l’élément du vécu intuitif des œuvres d’art dans un langage technique irréprochable où s’amorcent sans cesse des problématiques de fond. Ses élèves ont eu la chance de l’apprécier quotidiennement dans la spontanéité de l’exposé oral. Ils y furent séduits pour toujours par les improvisations d’un talent métaphorique magistralement contrôlé, d’où naissaient les entrelacs inattendus du sérieux conceptuel et éruditionnel avec la saveur de l’expérience immédiate des images. Pleinement à l’aise dans cette dimension vivante de la communication scientifique, Paul Philippot nous a ainsi appris de vive voix comment le style de la « Kunstwissenschaft » peut être celui du plaisir.
Un « Raphaël sans mains », c’est ainsi que Friedländer avait défini le type culturel et ce que l’on pourrait appeler la « structure libidinale » de l’historien d’art. Mais à la place de cet idéal privatif, un peu raide et triste, néoclassique encore, Paul Philippot a montré une autre image, plus souriante : celle d’une sorte de Claude Monet philosophe, doué à la fois d’une large palette de concepts rigoureux et d’un œil délié, intensément ouvert à toutes les nuances comme aux couleurs les plus vives – un artiste du savoir, qui pense l’art sur le motif, au grand air et dans la pleine lumière du musée imaginaire. »
Thierry LENAIN et Didier MARTENS
Professeurs à l’Université Libre de Bruxelles
In : Paul PHILIPPOT, Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre. Une vision humaniste. Hommage en forme de florilège, Courtrai, Groeninghe Eds, 1990
BRIGITTE D’HAINAUT-ZVENY
Merveilleux professeur d’auditoire, Paul Philippot eut, en outre, le souci constant de prolonger son enseignement par un contact direct avec les oeuvres, en entraînant, aussi souvent que possible, ses élèves sur le terrain. Ce souci s’est concrétisé par la visite de nombreuses expositions, par l’organisation d’excursions à travers toute la Belgique et par les multiples « invitations au voyage » qu’il lança aux étudiants tout au long de leurs années de formation et qui nous amenèrent de Londres à Berlin en passant par Vienne, Paris, Munich, Amsterdam et Rome.
Par ce contact, il s’attachait à développer le plaisir, la jouissance de l’oeuvre et complétait son enseignement en attirant notre attention sur sa réalité matérielle. Les détails de texture ou d’exécution, trop souvent estompés sur les diapositives présentées durant les cours, étaient l’objet d’un examen attentif. Il nous faisait par exemple percevoir la nature foncièrement différente d’un brocard chez Van Eyck, Pourbus ou Rubens et resituait cette microstructure – emblématique de la démarche de l’artiste – dans le cadre des enjeux fondamentaux qui caractérisent son individualité artistique. La traversée des dédales des grands musées internationaux lui permettait, en outre, de donner libre cours à toute la puissance de son esprit de synthèse. En brossant de larges esquisses chronologiques, il intégrait, autour de quelques axes essentiels, un ensemble de notions qui demeuraient trop souvent fragmentaires dans l’esprit des étudiants, isolées et inutilisables, parce que satellisées vis-à-vis d’une quelconque problématique. Les filiations et les ruptures stylistiques devenaient évidentes, Rubens retrouvait le Titien et l’alternative radicale proposée par le Caravage prenait tout son sens face à l’idéalisme totalisant des Carrache.
Ces voyages étaient aussi l’occasion d’aborder l’examen de certaines productions artistiques ne figurant pas dans les programmes de la section d’Histoire de l’Art. Nous lui devons, entre autres moments de grâce, la perception subjuguée de l’extraordinaire cohérence organique des éclaboussements décoratifs du Rococo allemand, ainsi que la conscience claire – et pour tout dire physique, puisqu’acquise à la force du mollet – de la très large diffusion du Palladianisme en Angleterre. Mais surtout, soucieux de décloisonner toute forme de connaissance, il nous obligeait à prendre conscience de l’importance des échanges existant entre les divers foyers culturels et s’attachait à extirper les tendances trop étroitement monographiques, latentes chez beaucoup d’historiens d’art, souvent tentés de reconstruire l’univers artistique autour de l’omphalos de l’artiste auquel ils réservent leurs soins jaloux.
Par ce contact direct avec les oeuvres, il nous a permis de prendre conscience de l’extraordinaire polysémie de l’oeuvre d’art. Effet de croyances réfractées, l’image est en effet une somme de virtualités qui développe des usages aussi différents que les motifs qui génèrent sa formation ou les causes mêmes de son apparition. Beaucoup d’entre nous en eurent l’éclairante démonstration, un samedi pluvieux quand, sortant de l’église Saint-Martin de Hal, la tête farcie de motifs en feuille de chou, nous fûmes encerclés par une foule de pèlerins et de malades qui effectuaient en chantant les sept tours votifs autour de l’édifice. Choc entre une réalité livresque et l’usage qui était fait des choses. En un éclair, nous avons eu une conscience aiguë de ce que J. Le Goff appelait, un peu malicieusement, « le long Moyen Age » et nous avons mesuré l’absolue nécessité de ne jamais limiter la nature, les fonctions et les usages de l’image. Comme Monsieur Jourdain, nous avions appris à faire de la sémiologie et il nous était désormais impossible de tenir le discours de la gratuité vertueuse de l’art ou d’en limiter sa lecture au seul aspect formel. Par sa pensée fondamentalement dialectique, Paul Philippot avait situé notre discipline sur le canevas en perpétuelle tension des polarités complexes, des enjeux multiples et des fonctionnements différenciés qui constituent le support « élastique » sur lequel se développe l’étude des sciences humaines.
Très attaché à la notion « d’objet symbolique » conceptualisée par Cesare Brandi, Paul Philippot a toujours été soucieux de décrypter dans l’oeuvre la présence d’une « image mentale », constituée par la projection de la représentation particulière que se font les divers agents d’une réalité sociale. Ainsi, au sortir de la crypte viennoise des capucins où s’entassent les prestigieux et très poussiéreux mausolées des principaux membres de la dynastie des Habsbourg, il nous emmena au café Mozart et évoqua, sur le ton léger de l’anecdote, d’autres usages funéraires, tels ceux pratiqués au Mexique où, lors des célébrations organisées en l’honneur des défunts, chacun se voit offrir une tête de mort en sucre portant son prénom, qu’il se doit de manger le jour de la Toussaint. Étrange phénomène de réappropriation de sa propre mort qui ne pouvait que souligner les différences existant entre les sensibilités funéraires de divers milieux et de différentes époques. Contraste étonnant entre les « pompes baroques » et les « fast pompes » de notre monde occidental où la mort – évacuée – ne laisse qu’une odeur d’antiseptique qui nous rappelait que l’expression artistique est la transcription individuelle d’un « ton de sentiment » plus ou moins largement diffusé et que celui-ci constitue un outil de connaissance historique dont on ne peut en aucun cas négliger l’apport.
Encore faut-il savoir utiliser au mieux cette source très particulière. D’une ironie parfois perfide à l’encontre des tenants de la « théorie du reflet » qui considèrent, d’une manière trop étroitement « mécaniste », la production artistique comme un miroir de la réalité historique, Paul Philippot nous engageait à remplacer avantageusement celle-ci par la « théorie des diffractions ». Réalité à la fois réelle et étrangère à l’existant, l’oeuvre d’art n’est pas le scanner d’une réalité, mais un champ où s’affrontent dialectiquement la « positivité » et la « négativité » d’un réel, qui est tout à fois donné, transcrit, oblitéré, refoulé, aménagé ou refusé. Cette volonté de réintégrer la subjectivité, celle du chercheur et celle du sujet étudié, dans l’analyse artistique, en rompant avec les pudeurs positivistes qui s’essayèrent à une approche « clinique » sans rapport avec la nature spécifique de la matière étudiée, contribua à rendre à l’Histoire de l’Art tout son intérêt et sa raison particulière d’être.
Avocat infatigable de la spécificité de sa discipline, Paul Philippot a toujours plaidé pour que celle-ci s’affirme par des méthodes d’investigations propres sans s’effrayer de la tyrannie de l’archive que font régner certains « notaires de l’histoire » qui, dans l’inquiétude de leur quête d’un référent absolu, ont développé une véritable mystique de l’écrit. Le document d’archive, Paul Philippot l’a souligné tout au long de sa carrière, est une source fondamentale à laquelle les historiens d’art devraient s’astreindre à avoir beaucoup plus systématiquement recours. Mais les deux types de sources sont confrontées au même problème de critique interne; il s’agit toujours de gérer l’ensemble des subjectivités qui émaillent le document, tant au niveau de sa constitution, que de sa transmission ou de son interprétation. Aussi, plutôt que de camper sur une hiérarchie des valeurs – héritage de l’histoire de l’émancipation des sciences humaines – ne serait-il pas plus « sérieux » d’additionner leurs acquis, ainsi qu’il l’a inlassablement préconisé, que ce soit par une plus grande ouverture des chercheurs des différentes spécialisations ou par la mise sur pied de groupes interdisciplinaires de travail, qui permettraient de confronter et d’ajuster les potentialités des diverses méthodes ?
Enfin, et ce n’est pas là le moindre de ses apports, son enseignement nous a habitués à pratiquer le salutaire exercice du « Γνῶθι σαυτόν », car c’est une expérience de vie et un présupposé fondamental à toute recherche qu’il s’attachait ainsi à développer chez chacun d’entre nous. Cette démarche faisait partie intégrante de son enseignement, mais beaucoup d’entre nous se souviennent d’un épisode plus particulièrement allégorique, que n’aurait pas désavoué Gabriel Garcia Marquez. En voyage à Vienne quelques jours avant l’ouverture de la très belle exposition « Traum und Wirklicheit » (1985), nous longions le Palais des Expositions, quand un coup de vent – coquin — arracha plusieurs feuilles d’or aux ouvriers affairés aux derniers préparatifs. Le ciel fut soudain envahi de dizaines de papillons dorés qui tombaient en tourbillonnant doucement, et ce fût un véritable «happening» symboliste. Les économes se précipitèrent pour glisser précautionneusement ce trésor dans leur portefeuille, certains pris d’une frénésie sacrée ou sacrilège se mirent à exécuter une fantastique danse totémique, quelques Danaé se glissèrent les yeux fermés, sous cette pluie d’emballages de chocolats, tandis que d’autres, interdits par le caractère insolite et provocateur de la situation, n’osaient agir. Une fois l’ondée passée, nous nous sommes inquiétés de notre guide. Un peu à l’écart, il observait la scène d’un regard bleu qui, par son acuité amusée, était à lui seul une leçon de vision ainsi qu’une impérative invitation à gérer, avec toute la rigueur nécessaire, notre subjectivité interprétative; à l’utiliser pour ses qualités cognitives propres sans jamais nous noyer dans une auscultation narcissique de notre ego.
Tous ces moments inoubliables nous ont appris, dans un registre plus profond que celui de la seule connaissance universitaire. Paul Philippot nous a fait comprendre de la façon la plus concrète et la plus riche que l’oeuvre d’art a une existence tout à la fois multiple et autonome, il nous a initiés au plaisir de son usage et à la richesse de ses analyses. Son enseignement fut une école d’art et une école de vie. Hommage lui soit ici rendu.
Brigitte D’Hainaut-Zveny
Codirectrice du groupe d’Etudes sur le XVIIIe siècle / Membre titulaire de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique / Chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles


Actualités
19 Janvier 2016

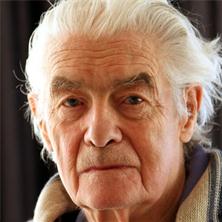 Paul Philippot professeur
Paul Philippot professeur« Pour tous ceux qui eurent la chance d’en bénéficier, l’enseignement de Paul Philippot ne fut pas seulement l’occasion d’une rencontre prolongée avec le savoir ample, profond et varié d’un véritable humaniste. Il fut aussi une invitation permanente à assumer une position d’autonomie active vis-à-vis des conformismes pesant sur la Kunstwissenschaft, conformismes liés à la fois aux formes de discours prescrites par l’institution universitaire et à la conception courante du savoir scientifique, mais particulièrement inadéquats dans le cas de la discipline qui est la nôtre. Sans bien sûr abandonner aucune des exigences de rigueur et de probité constitutives du discours scientifique traditionnel, sans davantage s’attacher le moins du monde aux signes extérieurs de la contestation, le travail pédagogique accompli par Paul Philippot à l’Université Libre de Bruxelles, fut celui d’une véritable libération.
Nous aimerions en rappeler quelques aspects.
L’un des rapports les plus sensibles de cet enseignement est sans doute de nous avoir largement affranchis d’une tendance au refoulement de la subjectivité, qui domine le discours sur la culture du passé. De façon très générale en effet, le savoir universitaire, pris comme ensemble indissociable de méthodes et de valeurs, détermine la subjectivité du regard comme un élément parasite, vecteur d’erreur et d’obscurité : c’est la puissance aveugle et perturbatrice de l’irréfléchi, du pur caprice inconsistant, qui vient toujours troubler la procession du savoir. S’il est vrai qu’aujourd’hui les déclarations de principe vont souvent à l’encontre de cette préconception elle n’en demeura pas moins, consciemment ou non, très active dans la pratique de l’historien d’art. Or, cette hostilité plus ou moins tacite vis-à-vis de la subjectivité n’a pas pour seule conséquence malheureuse d’appauvrir la notion même d’objectivité, laquelle se voit réduite au statut d’une vertu plutôt mesquine, comme si la rigueur scientifique n’était au fond que l’art purement réactif d’éviter les sollicitations frivoles. Elle n’a pas non plus pour seul effet néfaste de favoriser par défaut le retour d’une subjectivité devenue effectivement triviale du fait de n’avoir pas été assumée, travaillée, éduquée dans la perspective du savoir. Plus grave encore, la pratique scientifique de l’historien de d’art se voit ainsi privée d’outils de connaissance parfaitement adaptés au champ spécifique qui est le sien. Contre cette propension, donc, l’enseignement de Paul Philippot a su faire valoir les droits du regard subjectif considéré comme instance pleinement positive du savoir scientifique sur l’art.
Dans ses leçons sur l’histoire de la peinture, Paul Philippot se référait volontiers à l’expérience personnelle immédiate qu’il avait eue devant les œuvres originales, à l’impact décisif de cette expérience sur son questionnement. Introduisant son cours sur le Caravagisme, il racontait qu’il avait eu un jour, dans la « chapelle Contarelli » à Rome, l’intuition subite qu’il y avait bien plus que la recette du clair-obscur, mais une vraie problématique de style pictural ; et qu’ « au fond, le Caravage, c’était en quelque sorte le Rembrandt italien. Jusqu’ici, ajoutait-il, je ne m’étais jamais vraiment intéressé à ce peintre, mais à partir de ce moment, j’eus le désir de savoir quelle était exactement la situation présente du discours critique sur le Caravage ». Paul Philippot affirmait ainsi d’entrée de jeu que, pour lui, le point de départ d’une recherche pouvait fort bien se situer dans la sphère intime des associations spontanées suscitées par l’œuvre, et non tout d’abord dans l’espace public de la littérature d’histoire de l’art et de ses interrogations traditionnelles. Pour nous, un tel aveu liminaire signifiait non seulement que la subjectivité avait sa place dans la « Kunstwissenschaft », mais en outre qu’elle pouvait même constituer un outil cognitif de premier ordre. Dans son cours d’esthétique, Paul Philippot proposait d’ailleurs de concevoir l’histoire de l’art comme une critique d’art qui se développe en termes de conscience historique, critique où l’appréciation de la valeur esthétique ne peut par conséquent jamais disparaître dans un relativisme pur et simple.
Bien entendu, il ne s’agit pas pour autant de réduire la démarche critique à ce seul moment de l’appréhension subjective immédiate, mais bien de l’utiliser au profit de l’interprétation critico-historique la plus rigoureuse. C’est dire que l’intuition esthétique directe, procédant du contact immédiat avec l’œuvre, ne livre ses richesses que si elle vient jouer dans le système complexe et bien architecturé des médiations théoriques. Ce système est formé, d’une part, de la masse des connaissances factuelles touchant non seulement les œuvres du musée imaginaire, prises dans leurs déterminations géographiques et chronologiques, mais aussi leur fortune critique, toujours indissociable du corpus lui-même. Il se compose d’autre part des concepts qui permettent de s’orienter dans ce corpus selon une perspective déterminée, en fonction d’un projet interprétatif lié de la façon la plus étroite possible à notre situation culturelle fondamentale. Ce qu’il faut viser toujours, c’est donc l’établissement d’une sorte de réseau d’échanges à double sens entre le contact immédiat avec l’œuvre et la réflexion théorique proprement dite, laquelle a charge de manœuvrer ces médiations complexes que sont les concepts et les connaissances d’érudition. Outre l’acquisition d’une maîtrise du côté « objectif », une telle démarche implique par conséquent la nécessité d’un travail permanent sur la subjectivité intuitive, afin précisément de la rendre apte à dialoguer avec les médiations théoriques.
L’enseignement de Paul Philippot s’est donné comme une invitation toujours renouvelée à nous livrer sans compter à cet entraînement du regard connaissant. Une subjectivité formée par un tel travail n’aura donc rien à voir avec l’insupportable petit « moi » qui, en art surtout, se persuade toujours qu’il a pleine voix au chapitre. Cette subjectivité-là, tout homme de science a raison de l’écarter avec agacement. Paul Philippot a fait mieux que cela. Sachant tourner l’agacement en une ironie intellectuelle légère et incisive, il l’exerçait au profit d’une réflexion supplémentaire sur la formation du regard. Quelque fois dans ses cours, le plus souvent en marge de ceux-ci, lors de contacts informels avec les étudiants, il se plaisait à indiquer les exemples de subjectivisme sauvage à ne pas suivre, et ne se privait pas d’analyser les vices du sujet trivial et leur fonctionnement – non sans jubilation, mais toujours aux fins positives d’une pédagogie de dissuasion des plus efficaces…
Mais là ne se borne pas l’apport libérateur de son enseignement. Il s’est aussi exercé sur l’aspect complémentaire de la subjectivité bien comprise, par l’attention et le goût portés aux aspects proprement philosophiques de la « Kunstwissenschaft ». L’éducation de l’intuition peut être l’essentiel sans l’optique de la « Kennerschaft » - bien que, même dans ce cas, l’on ne puisse jamais se passer tout à fait de concepts bien ancrés. Mais elle s’avère forcément insuffisante pour un savoir fondamental. Celui-ci demande encore le développement de concepts généraux fondés et liés entre eux, ainsi que l’appréhension des enjeux ultimes, jamais évidents, de la pratique même du savoir scientifique considéré. Sur ce plan essentiel, la pédagogie de Paul Philippot s’est également avérée des plus fécondes : elle n’a cessé de favoriser la créativité conceptuelle dans les cadres de l’histoire de l’art, ainsi que la réflexion de fond sur les aspects les plus généraux des problèmes posés par celle-ci, à la fois comme science particulière et par rapport à l’expérience culturelle en général.
Une lecture assidue et toujours originale des grands philosophes avait ouvert à Paul Philippot des accès précieux aux textes fondateurs de notre discipline, tels l’ « Esthétique » de Hegel. Elle lui a également inspiré une réflexion personnelle sur ses fondements actuels, en particulier dans le sillage de la phénoménologie. Cela aussi, il nous l’a fait partager, ne serait-ce qu’en diffusant dans son cours d’esthétique les théories de Cesare Brandi – lesquelles seraient probablement restées inconnues dans le domaine francophone s’il n’avait su nous en montrer la fécondité particulière. Dès lors, si les historiens d’art formés par Paul Philippot ont eu l’occasion de se trouver supérieurement « armés » sur le plan des concepts, ils se sont surtout vu offrir la possibilité d’une rare liberté dans l’exercice de leur savoir. Car en nous communiquant une expérience approfondie des questions théoriques les plus lointaines de la réflexion sur l’histoire de l’art, son enseignement nous a invités à revoir et à réinventer toujours les fondements et les enjeux de notre discipline, ainsi qu’à appréhender toute l’étendue et toute la profondeur de ses possibilités. C’est ainsi que Paul Philippot n’a jamais hésité à encourager le questionnement historico-esthétique sur les objets les plus divers de l’histoire des formes. Nombreux sont les contemporanéistes à avoir bénéficié de l’ouverture et de l’acuité exceptionnelles du regard porté sur l’art moderne, y compris en ses avancées les plus radicales, par ce grand spécialiste de l’art ancien. Mais cette aptitude à élargir le champ de la réflexion esthétique s’est aussi exercée dans d’autres domaines que ceux de la culture occidentale et à d’autres niveaux que celui de la sphère artistique proprement dite. Nous avons, par exemple, beaucoup appris de ces anecdotes de voyage où il s’entend si bien à faire apparaître comment les différences historiques et culturelles profondes se manifestent de façon concrète dans la dimension du quotidien, des mœurs ou des formes psychologiques courantes. A un autre niveau encore, les systèmes philosophiques eux-mêmes n’ont-ils pas leurs rythmes et leurs formes ?
Pourtant, si l’on peut dire que Paul Philippot a libéré le champ d’exercice de la « Kunstwissenschaft » en l’ouvrant souvent bien au-delà des limites du musée imaginaire, aux dimensions d’une sorte d’esthétique généralisée, il importe de rappeler aussi combien il a su nous rendre attentifs à éviter que cette extension ne débouche sur une double dissolution des méthodes et de l’objet spécifiques de notre science. L’un des soucis les plus constants qu’il ait inculqués, peut-être son souci central, consiste à refuser toute abdication de la question de l’art comme histoire de styles. Car une telle dissolution est le principal danger qui la guette, à une époque où elle ne peut certes plus ignorer la pertinence fondamentale des créations contemporaines, inspirées en grande partie par la critique du primat de l’exigence stylistique, pas plus qu’elle ne peut se passer d’échanges méthodologiques poussés avec d’autres disciplines du savoir scientifique. La démarche qui paraît avoir toujours guidé la pensée de Paul Philippot reste à cet égard d’une justesse particulière, et ses élèves n’ont pas fini de la méditer. Comme une sorte d’écologie de la méthode, elle revient en somme à reconnaître la valeur et la richesse des savoirs qui nous ont précédés sur notre propre terrain et l’ont pour ainsi dire ouvert à notre liberté. Elle revient à faire fond sur le legs méthodologique de la « Kunstwissenschaft », dont la tradition remonte au moins à Wölfflin, et à considérer ce legs comme une ferme base de départ qui demeure toujours le foyer d’orientation des réformes ou dérives critiques, parfois fort lointaines, qu’imposent les déterminations de notre époque. Si l’on ne saurait nier que l’art contemporain exige entre autres la critique de la notion de style, toute-puissante aux aurores de la « Kunstwissenschaft », cela n’implique nullement que l’on puisse la répudier dans l’étude des arts anciens. Bien plus, l’approche de l’art contemporain lui-même, dont la spécificité n’apparaît dans sa profondeur que sur le fond de perspective historique, demande plutôt que cette notion soit conservée et repensée, fût-ce en négatif, comme un concept opératoire toujours prégnant.
Jamais donc, Paul Philippot n’aura contribué à figer l’histoire de l’art sur son acquis. Mais jamais non plus on ne l’a pris à répandre le sentiment décourageant d’une déperdition au niveau de la spécificité de notre discipline et d’un effritement de son ancrage dans une tradition de pensée. Il sut au contraire nous prémunir des égarements trop faciles au fil desquels les méthodes et l’objet central de l’histoire de l’art se décomposent et se confondent. Cette souple vigilance, fondée sur la conscience d’un balancement nécessaire de la méthode entre le centre et les décentrements, constitue au demeurant le principe de l’originalité réelle de ses contacts avec les autres disciplines, rapportant leurs méthodes et leurs questions à la pratique et aux problèmes du regard historico-esthétique comme tel.
Nul doute que l’ampleur théorique de l’histoire de l’art pratiquée par Paul Philippot soit précisément ce qui en fait un directeur de recherches des plus ouverts, même aux projets très éloignés de son « domaine ». Tant au niveau d’une thèse de doctorat que pour un mémoire de licence, ceux qu’il a aidés n’ont pu manquer d’être frappés par la rapidité et la vigueur avec laquelle il saisit une problématique relevante, en cerne l’enjeu et devance la réflexion, soutenant ainsi les mouvements de la recherche. Et s’il est vrai que le désir d’étonner le maître compte pour beaucoup dans ce qui fait avancer l’élève, d’emblée la barre se plaçait haut de ce point de vue. Est-ce encore le fait conscient de sa pédagogie si, sans jamais marquer la distance du maître à l’élève, bien au contraire, Paul Philippot a souvent produit l’espèce de choc en retour par lequel l’étonnement revenait aussitôt frapper qui s’adressait à lui ?
Enfin, son enseignement eut encore un effet libérateur par rapport aux conditionnements qui peuvent résulter de notre appartenance à un espace linguistique et culturel déterminé. L’ « italianisme » de Paul Philippot fut pour nous la preuve vécue qu’il était possible, pour un Belge francophone, de participer pleinement d’une tradition théorique et critique autre que la tradition française, et de s’insérer par choix délibéré dans un espace de pensée et de discussion auquel on n’appartient ni par la langue ni par la formation reçue. Aucun des autres aspects mis en évidence ne peut d’ailleurs se dissocier de cet enrichissement culturel considérable qui procéda d’une immersion active dans le milieu italien. Celle-ci fut déterminante quant à la conscience des ressources de l’intuition subjective, pour une très large part l’apanage de la critique italienne. Et les élaborations théoriques de Croce, d’Argan ou de Brandi furent autant d’apports essentiels pour l’ouverture théorique de l’histoire de l’art précisément conçue comme discipline du regard historique sur les œuvres elles-mêmes ; autant de passerelles à double sens pour cheminer entre le regard et le concept, entre « Kunstwissenschaft » et philosophie.
A travers ces quelques brèves remarques, il apparaît combien l’enseignement dispensé par Paul Philippot fut loin de se borner à la transmission d’un ensemble de connaissances. C’est une certaine conception vécue du « métier » d’historien d’art que nous lui devons, l’exemple d’un style de savoir. Ce style, nous le voyons porté surtout par une manière de traduire l’élément du vécu intuitif des œuvres d’art dans un langage technique irréprochable où s’amorcent sans cesse des problématiques de fond. Ses élèves ont eu la chance de l’apprécier quotidiennement dans la spontanéité de l’exposé oral. Ils y furent séduits pour toujours par les improvisations d’un talent métaphorique magistralement contrôlé, d’où naissaient les entrelacs inattendus du sérieux conceptuel et éruditionnel avec la saveur de l’expérience immédiate des images. Pleinement à l’aise dans cette dimension vivante de la communication scientifique, Paul Philippot nous a ainsi appris de vive voix comment le style de la « Kunstwissenschaft » peut être celui du plaisir.
Un « Raphaël sans mains », c’est ainsi que Friedländer avait défini le type culturel et ce que l’on pourrait appeler la « structure libidinale » de l’historien d’art. Mais à la place de cet idéal privatif, un peu raide et triste, néoclassique encore, Paul Philippot a montré une autre image, plus souriante : celle d’une sorte de Claude Monet philosophe, doué à la fois d’une large palette de concepts rigoureux et d’un œil délié, intensément ouvert à toutes les nuances comme aux couleurs les plus vives – un artiste du savoir, qui pense l’art sur le motif, au grand air et dans la pleine lumière du musée imaginaire. »
Thierry LENAIN et Didier MARTENS
Professeurs à l’Université Libre de Bruxelles
In : Paul PHILIPPOT, Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre. Une vision humaniste. Hommage en forme de florilège, Courtrai, Groeninghe Eds, 1990
BRIGITTE D’HAINAUT-ZVENY
Merveilleux professeur d’auditoire, Paul Philippot eut, en outre, le souci constant de prolonger son enseignement par un contact direct avec les oeuvres, en entraînant, aussi souvent que possible, ses élèves sur le terrain. Ce souci s’est concrétisé par la visite de nombreuses expositions, par l’organisation d’excursions à travers toute la Belgique et par les multiples « invitations au voyage » qu’il lança aux étudiants tout au long de leurs années de formation et qui nous amenèrent de Londres à Berlin en passant par Vienne, Paris, Munich, Amsterdam et Rome.
Par ce contact, il s’attachait à développer le plaisir, la jouissance de l’oeuvre et complétait son enseignement en attirant notre attention sur sa réalité matérielle. Les détails de texture ou d’exécution, trop souvent estompés sur les diapositives présentées durant les cours, étaient l’objet d’un examen attentif. Il nous faisait par exemple percevoir la nature foncièrement différente d’un brocard chez Van Eyck, Pourbus ou Rubens et resituait cette microstructure – emblématique de la démarche de l’artiste – dans le cadre des enjeux fondamentaux qui caractérisent son individualité artistique. La traversée des dédales des grands musées internationaux lui permettait, en outre, de donner libre cours à toute la puissance de son esprit de synthèse. En brossant de larges esquisses chronologiques, il intégrait, autour de quelques axes essentiels, un ensemble de notions qui demeuraient trop souvent fragmentaires dans l’esprit des étudiants, isolées et inutilisables, parce que satellisées vis-à-vis d’une quelconque problématique. Les filiations et les ruptures stylistiques devenaient évidentes, Rubens retrouvait le Titien et l’alternative radicale proposée par le Caravage prenait tout son sens face à l’idéalisme totalisant des Carrache.
Ces voyages étaient aussi l’occasion d’aborder l’examen de certaines productions artistiques ne figurant pas dans les programmes de la section d’Histoire de l’Art. Nous lui devons, entre autres moments de grâce, la perception subjuguée de l’extraordinaire cohérence organique des éclaboussements décoratifs du Rococo allemand, ainsi que la conscience claire – et pour tout dire physique, puisqu’acquise à la force du mollet – de la très large diffusion du Palladianisme en Angleterre. Mais surtout, soucieux de décloisonner toute forme de connaissance, il nous obligeait à prendre conscience de l’importance des échanges existant entre les divers foyers culturels et s’attachait à extirper les tendances trop étroitement monographiques, latentes chez beaucoup d’historiens d’art, souvent tentés de reconstruire l’univers artistique autour de l’omphalos de l’artiste auquel ils réservent leurs soins jaloux.
Par ce contact direct avec les oeuvres, il nous a permis de prendre conscience de l’extraordinaire polysémie de l’oeuvre d’art. Effet de croyances réfractées, l’image est en effet une somme de virtualités qui développe des usages aussi différents que les motifs qui génèrent sa formation ou les causes mêmes de son apparition. Beaucoup d’entre nous en eurent l’éclairante démonstration, un samedi pluvieux quand, sortant de l’église Saint-Martin de Hal, la tête farcie de motifs en feuille de chou, nous fûmes encerclés par une foule de pèlerins et de malades qui effectuaient en chantant les sept tours votifs autour de l’édifice. Choc entre une réalité livresque et l’usage qui était fait des choses. En un éclair, nous avons eu une conscience aiguë de ce que J. Le Goff appelait, un peu malicieusement, « le long Moyen Age » et nous avons mesuré l’absolue nécessité de ne jamais limiter la nature, les fonctions et les usages de l’image. Comme Monsieur Jourdain, nous avions appris à faire de la sémiologie et il nous était désormais impossible de tenir le discours de la gratuité vertueuse de l’art ou d’en limiter sa lecture au seul aspect formel. Par sa pensée fondamentalement dialectique, Paul Philippot avait situé notre discipline sur le canevas en perpétuelle tension des polarités complexes, des enjeux multiples et des fonctionnements différenciés qui constituent le support « élastique » sur lequel se développe l’étude des sciences humaines.
Très attaché à la notion « d’objet symbolique » conceptualisée par Cesare Brandi, Paul Philippot a toujours été soucieux de décrypter dans l’oeuvre la présence d’une « image mentale », constituée par la projection de la représentation particulière que se font les divers agents d’une réalité sociale. Ainsi, au sortir de la crypte viennoise des capucins où s’entassent les prestigieux et très poussiéreux mausolées des principaux membres de la dynastie des Habsbourg, il nous emmena au café Mozart et évoqua, sur le ton léger de l’anecdote, d’autres usages funéraires, tels ceux pratiqués au Mexique où, lors des célébrations organisées en l’honneur des défunts, chacun se voit offrir une tête de mort en sucre portant son prénom, qu’il se doit de manger le jour de la Toussaint. Étrange phénomène de réappropriation de sa propre mort qui ne pouvait que souligner les différences existant entre les sensibilités funéraires de divers milieux et de différentes époques. Contraste étonnant entre les « pompes baroques » et les « fast pompes » de notre monde occidental où la mort – évacuée – ne laisse qu’une odeur d’antiseptique qui nous rappelait que l’expression artistique est la transcription individuelle d’un « ton de sentiment » plus ou moins largement diffusé et que celui-ci constitue un outil de connaissance historique dont on ne peut en aucun cas négliger l’apport.
Encore faut-il savoir utiliser au mieux cette source très particulière. D’une ironie parfois perfide à l’encontre des tenants de la « théorie du reflet » qui considèrent, d’une manière trop étroitement « mécaniste », la production artistique comme un miroir de la réalité historique, Paul Philippot nous engageait à remplacer avantageusement celle-ci par la « théorie des diffractions ». Réalité à la fois réelle et étrangère à l’existant, l’oeuvre d’art n’est pas le scanner d’une réalité, mais un champ où s’affrontent dialectiquement la « positivité » et la « négativité » d’un réel, qui est tout à fois donné, transcrit, oblitéré, refoulé, aménagé ou refusé. Cette volonté de réintégrer la subjectivité, celle du chercheur et celle du sujet étudié, dans l’analyse artistique, en rompant avec les pudeurs positivistes qui s’essayèrent à une approche « clinique » sans rapport avec la nature spécifique de la matière étudiée, contribua à rendre à l’Histoire de l’Art tout son intérêt et sa raison particulière d’être.
Avocat infatigable de la spécificité de sa discipline, Paul Philippot a toujours plaidé pour que celle-ci s’affirme par des méthodes d’investigations propres sans s’effrayer de la tyrannie de l’archive que font régner certains « notaires de l’histoire » qui, dans l’inquiétude de leur quête d’un référent absolu, ont développé une véritable mystique de l’écrit. Le document d’archive, Paul Philippot l’a souligné tout au long de sa carrière, est une source fondamentale à laquelle les historiens d’art devraient s’astreindre à avoir beaucoup plus systématiquement recours. Mais les deux types de sources sont confrontées au même problème de critique interne; il s’agit toujours de gérer l’ensemble des subjectivités qui émaillent le document, tant au niveau de sa constitution, que de sa transmission ou de son interprétation. Aussi, plutôt que de camper sur une hiérarchie des valeurs – héritage de l’histoire de l’émancipation des sciences humaines – ne serait-il pas plus « sérieux » d’additionner leurs acquis, ainsi qu’il l’a inlassablement préconisé, que ce soit par une plus grande ouverture des chercheurs des différentes spécialisations ou par la mise sur pied de groupes interdisciplinaires de travail, qui permettraient de confronter et d’ajuster les potentialités des diverses méthodes ?
Enfin, et ce n’est pas là le moindre de ses apports, son enseignement nous a habitués à pratiquer le salutaire exercice du « Γνῶθι σαυτόν », car c’est une expérience de vie et un présupposé fondamental à toute recherche qu’il s’attachait ainsi à développer chez chacun d’entre nous. Cette démarche faisait partie intégrante de son enseignement, mais beaucoup d’entre nous se souviennent d’un épisode plus particulièrement allégorique, que n’aurait pas désavoué Gabriel Garcia Marquez. En voyage à Vienne quelques jours avant l’ouverture de la très belle exposition « Traum und Wirklicheit » (1985), nous longions le Palais des Expositions, quand un coup de vent – coquin — arracha plusieurs feuilles d’or aux ouvriers affairés aux derniers préparatifs. Le ciel fut soudain envahi de dizaines de papillons dorés qui tombaient en tourbillonnant doucement, et ce fût un véritable «happening» symboliste. Les économes se précipitèrent pour glisser précautionneusement ce trésor dans leur portefeuille, certains pris d’une frénésie sacrée ou sacrilège se mirent à exécuter une fantastique danse totémique, quelques Danaé se glissèrent les yeux fermés, sous cette pluie d’emballages de chocolats, tandis que d’autres, interdits par le caractère insolite et provocateur de la situation, n’osaient agir. Une fois l’ondée passée, nous nous sommes inquiétés de notre guide. Un peu à l’écart, il observait la scène d’un regard bleu qui, par son acuité amusée, était à lui seul une leçon de vision ainsi qu’une impérative invitation à gérer, avec toute la rigueur nécessaire, notre subjectivité interprétative; à l’utiliser pour ses qualités cognitives propres sans jamais nous noyer dans une auscultation narcissique de notre ego.
Tous ces moments inoubliables nous ont appris, dans un registre plus profond que celui de la seule connaissance universitaire. Paul Philippot nous a fait comprendre de la façon la plus concrète et la plus riche que l’oeuvre d’art a une existence tout à la fois multiple et autonome, il nous a initiés au plaisir de son usage et à la richesse de ses analyses. Son enseignement fut une école d’art et une école de vie. Hommage lui soit ici rendu.
Brigitte D’Hainaut-Zveny
Codirectrice du groupe d’Etudes sur le XVIIIe siècle / Membre titulaire de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique / Chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles
Galerie

Galerie

| 1 image | Diaporama |
FRANCAIS - ENGLISH
Connexion
Lettre d'information