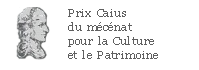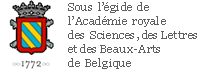C'est très simple...
Il suffit de poser votre candidature ici.
Il suffit de poser votre candidature ici.
Vous pouvez soutenir le projet Koregos de plusieurs façons. Cliquez ici pour tout savoir.
Conquêtes artistiques ou spoliations? Les saisies révolutionnaires françaises et la question des restitutions. Une conférence de Pierre-Yves Kairis

 Comme plusieurs autres ministres de différents gouvernements de notre pays, Mme Elke Sleurs, secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, a été interpellée à diverses reprises par des parlementaires quant à l’action que l’Etat belge pourrait entamer auprès de la République française en vue d’une récupération de pièces emportées par les troupes françaises à la Révolution. Dans la foulée, la secrétaire d’Etat a réuni en 2015 quelques experts pour faire le point sur le sujet. C’est dans ce contexte qu’un rapport historique a été demandé à l’IRPA. Celui-ci a été remis au cabinet Sleurs en octobre 2015. Il a depuis lors été publié sur le site de la Tribune de l’art :
Comme plusieurs autres ministres de différents gouvernements de notre pays, Mme Elke Sleurs, secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, a été interpellée à diverses reprises par des parlementaires quant à l’action que l’Etat belge pourrait entamer auprès de la République française en vue d’une récupération de pièces emportées par les troupes françaises à la Révolution. Dans la foulée, la secrétaire d’Etat a réuni en 2015 quelques experts pour faire le point sur le sujet. C’est dans ce contexte qu’un rapport historique a été demandé à l’IRPA. Celui-ci a été remis au cabinet Sleurs en octobre 2015. Il a depuis lors été publié sur le site de la Tribune de l’art :
www.latribunedelart.com/note-sur-les-tableaux-enleves-a-la-belgique-en-1794-et-restitues-ou-non-en-1815
Ce rapport a permis de nuancer la notion de saisies/spoliations/conquêtes artistiques – les termes utilisés ne sont pas neutres – en rappelant le contexte. Dès avant l’invasion des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège suite à la bataille de Fleurus du 26 juin 1794, plusieurs agences d’extraction avaient été mises en place. Les commissaires français adjoints aux troupes françaises ont d’emblée prélevé les pièces majeures du patrimoine des régions conquises, preuve que l’opération avait été minutieusement préparée depuis Paris. Si de nombreux livres, manuscrits, objets scientifiques et techniques, sans parler des archives, ont été envoyés à Paris, ce sont surtout les tableaux, et particulièrement les chefs-d’œuvre des peintres baroques flamands, qui ont fait l’objet des principales sollicitations. Il ne s’agissait toutefois pas de rapines individuelles, il s’agissait de prélèvements dûment programmés au nom de la République. L’objectif de la Convention était de réunir à Paris les chefs-d’œuvre de l’art européen. Les saisies portaient sur les chefs-d’œuvre susceptibles de rehausser le niveau des collections d’art nordique du Muséum central des Arts nouvellement ouvert au public. C’est dans un but d’éducation du public, et surtout de formation des jeunes artistes, que ces tableaux devaient être exposés au Louvre, souvent après restauration. L’affaire fut prestement réglée : plus de deux cents pièces furent transférées à Paris en huit mois de temps à peine. Les prélèvements continuèrent par la suite, mais au profit des musées locaux qu’il était envisagé de créer dans la plupart des départements belges.
La France ayant usé du même procédé lors des campagnes napoléoniennes d’Italie et d’Allemagne, le Muséum croulait bientôt sous les chefs-d’œuvre. Bonaparte décréta, en 1801, la création de quinze collections en province susceptibles de recevoir les surplus du Louvre afin de présenter à un plus large public des échantillons de toutes les écoles issus des glorieuses conquêtes de la Révolution. C’est le principe universaliste qui prévalut alors à la répartition des tableaux entre les différents musées nouvellement créés, au grand dam du conservateur du Musée de Bruxelles, qui espérait récupérer essentiellement des chefs-d’œuvre de la peinture flamande.
Suite à la première abdication de Napoléon en 1814, il fut admis que la France pouvait conserver tous les biens artistiques conquis. Après Waterloo, les Alliés, estimant avoir été trahi par l’armée française, se montrèrent plus revendicatifs et, ne trouvant pas d’accord avec les autorités françaises, ils récupérèrent par la force, sous l’impulsion des Prussiens, les œuvres spoliées qui se trouvaient au Louvre. Il n’y eut pas vraiment de restitutions : on a volé aux Français ce qu’ils avaient volé vingt ans plus tôt, alors que ces prélèvements avaient pourtant été régularisés par le Traité de Campo Formio du 18 octobre 1797 entre la France et l’Autriche. Mais la Belgique ne put généralement pas récupérer les œuvres qui avaient été envoyées en province. Un gros tiers environ des tableaux conquis rentrèrent au pays et le gouvernement belgo-hollandais continua à exiger le retour des œuvres envoyées dans les quinze musées de province.
Entre-temps, la France s’était redressée et elle réclamait à Bruxelles les soixante-neuf tableaux qu’elle y avait envoyés en deux envois, en 1802 et 1811. Finalement, un accord tacite fut conclu aux termes duquel chacun conservait les objets qu’il détenait. N’ayant pas été officiellement ratifié, cet accord fut vite oublié et les réclamations perdurèrent, avec une accélération marquée à partir des années 1990. Pourtant, comme l’a fait remarquer un tribunal parisien dans un récent arrêt, le pillage des œuvres d’art ne fut pas contraire au droit international jusqu’au XXe siècle. Il ne faut guère se faire d’illusions : on ne réécrira pas l’histoire !


Actualités
16 Février 2017

 Comme plusieurs autres ministres de différents gouvernements de notre pays, Mme Elke Sleurs, secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, a été interpellée à diverses reprises par des parlementaires quant à l’action que l’Etat belge pourrait entamer auprès de la République française en vue d’une récupération de pièces emportées par les troupes françaises à la Révolution. Dans la foulée, la secrétaire d’Etat a réuni en 2015 quelques experts pour faire le point sur le sujet. C’est dans ce contexte qu’un rapport historique a été demandé à l’IRPA. Celui-ci a été remis au cabinet Sleurs en octobre 2015. Il a depuis lors été publié sur le site de la Tribune de l’art :
Comme plusieurs autres ministres de différents gouvernements de notre pays, Mme Elke Sleurs, secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, a été interpellée à diverses reprises par des parlementaires quant à l’action que l’Etat belge pourrait entamer auprès de la République française en vue d’une récupération de pièces emportées par les troupes françaises à la Révolution. Dans la foulée, la secrétaire d’Etat a réuni en 2015 quelques experts pour faire le point sur le sujet. C’est dans ce contexte qu’un rapport historique a été demandé à l’IRPA. Celui-ci a été remis au cabinet Sleurs en octobre 2015. Il a depuis lors été publié sur le site de la Tribune de l’art :www.latribunedelart.com/note-sur-les-tableaux-enleves-a-la-belgique-en-1794-et-restitues-ou-non-en-1815
Ce rapport a permis de nuancer la notion de saisies/spoliations/conquêtes artistiques – les termes utilisés ne sont pas neutres – en rappelant le contexte. Dès avant l’invasion des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège suite à la bataille de Fleurus du 26 juin 1794, plusieurs agences d’extraction avaient été mises en place. Les commissaires français adjoints aux troupes françaises ont d’emblée prélevé les pièces majeures du patrimoine des régions conquises, preuve que l’opération avait été minutieusement préparée depuis Paris. Si de nombreux livres, manuscrits, objets scientifiques et techniques, sans parler des archives, ont été envoyés à Paris, ce sont surtout les tableaux, et particulièrement les chefs-d’œuvre des peintres baroques flamands, qui ont fait l’objet des principales sollicitations. Il ne s’agissait toutefois pas de rapines individuelles, il s’agissait de prélèvements dûment programmés au nom de la République. L’objectif de la Convention était de réunir à Paris les chefs-d’œuvre de l’art européen. Les saisies portaient sur les chefs-d’œuvre susceptibles de rehausser le niveau des collections d’art nordique du Muséum central des Arts nouvellement ouvert au public. C’est dans un but d’éducation du public, et surtout de formation des jeunes artistes, que ces tableaux devaient être exposés au Louvre, souvent après restauration. L’affaire fut prestement réglée : plus de deux cents pièces furent transférées à Paris en huit mois de temps à peine. Les prélèvements continuèrent par la suite, mais au profit des musées locaux qu’il était envisagé de créer dans la plupart des départements belges.
La France ayant usé du même procédé lors des campagnes napoléoniennes d’Italie et d’Allemagne, le Muséum croulait bientôt sous les chefs-d’œuvre. Bonaparte décréta, en 1801, la création de quinze collections en province susceptibles de recevoir les surplus du Louvre afin de présenter à un plus large public des échantillons de toutes les écoles issus des glorieuses conquêtes de la Révolution. C’est le principe universaliste qui prévalut alors à la répartition des tableaux entre les différents musées nouvellement créés, au grand dam du conservateur du Musée de Bruxelles, qui espérait récupérer essentiellement des chefs-d’œuvre de la peinture flamande.
Suite à la première abdication de Napoléon en 1814, il fut admis que la France pouvait conserver tous les biens artistiques conquis. Après Waterloo, les Alliés, estimant avoir été trahi par l’armée française, se montrèrent plus revendicatifs et, ne trouvant pas d’accord avec les autorités françaises, ils récupérèrent par la force, sous l’impulsion des Prussiens, les œuvres spoliées qui se trouvaient au Louvre. Il n’y eut pas vraiment de restitutions : on a volé aux Français ce qu’ils avaient volé vingt ans plus tôt, alors que ces prélèvements avaient pourtant été régularisés par le Traité de Campo Formio du 18 octobre 1797 entre la France et l’Autriche. Mais la Belgique ne put généralement pas récupérer les œuvres qui avaient été envoyées en province. Un gros tiers environ des tableaux conquis rentrèrent au pays et le gouvernement belgo-hollandais continua à exiger le retour des œuvres envoyées dans les quinze musées de province.
Entre-temps, la France s’était redressée et elle réclamait à Bruxelles les soixante-neuf tableaux qu’elle y avait envoyés en deux envois, en 1802 et 1811. Finalement, un accord tacite fut conclu aux termes duquel chacun conservait les objets qu’il détenait. N’ayant pas été officiellement ratifié, cet accord fut vite oublié et les réclamations perdurèrent, avec une accélération marquée à partir des années 1990. Pourtant, comme l’a fait remarquer un tribunal parisien dans un récent arrêt, le pillage des œuvres d’art ne fut pas contraire au droit international jusqu’au XXe siècle. Il ne faut guère se faire d’illusions : on ne réécrira pas l’histoire !
Informations pratiques

Lieu : Institut des Hautes Etudes de Belgique
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles
Date : Vendredi 17 février 2017 à 19h00
Conférencier : Pierre-Yves Kairis, Chef de département a.i. et chef de travaux principal à l'IRPA
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles
Date : Vendredi 17 février 2017 à 19h00
Conférencier : Pierre-Yves Kairis, Chef de département a.i. et chef de travaux principal à l'IRPA
Galerie

Galerie

| 1 image | Diaporama |
FRANCAIS - ENGLISH
Connexion
Lettre d'information