


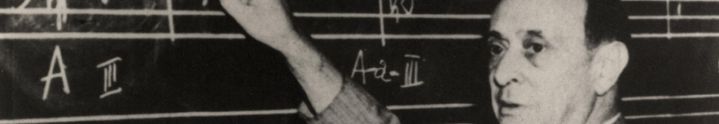
Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait d’un Bulletin de la Classe des Beaux-Arts de l’Académie royale de Belgique (2007, 6e série, T. 18, p. 316-372).
Les musiques modernes d’hier à aujourd’hui

Pour le plus grand nombre des amateurs de musique – ceux qui aiment Bach, Mozart ou Beethoven – le terme « musique moderne » est synonyme de « musique incompréhensible et perturbante » que l’on tolère au concert entre une symphonie classique et un concerto romantique, mais qui est rarement la bienvenu. En a-t-il toujours été de même dans le passé ? Nous savons que l’histoire de la musique ne s’est pas déroulée comme un long fleuve tranquille et qu’elle a connu des débats et des crises. Mais ces crises ont-elles été de même nature que celle que nous connaissons aujourd’hui ? Sachant que le renouvellement de la forme et des contenus de la musique à un rythme plus ou moins rapide est une constante dans toutes les sociétés, je voudrais tenter de comprendre comment certaines musiques nouvelles ont été perçues comme « modernes », c’est-à-dire non comme le prolongement naturel du passé, mais comme une rupture regrettable.
Une différence essentielle entre la musique d’aujourd’hui et les musiques du passé, c’est qu’aujourd’hui la musique veut n’être écoutée que pour elle-même, veut être dégagée de toute contingence sociale, veut être un art pur, tandis que les musiques du passé ont longtemps accepté de se subordonner à d’autres activités, de n’être qu’un support d’autre chose : faire marcher, faire danser, divertir, émouvoir, aider les fidèles à s’unir dans la prière, célébrer plus intensément les joies et les douleurs, les espérances et les certitudes de leur communauté spirituelle. Fonctionnalité d’un côté, pureté et formalisme de l’autre, est-ce cela qui fait la différence ? Pas entièrement, car les musiques fonctionnelles ne sont jamais vierges de préoccupations esthétiques et ces préoccupations peuvent entraîner des transformations formelles, susceptibles de perturber la fonctionnalité. Par ailleurs, les musiques dites pures ne sont pas seulement formelles, elles recèlent toujours une part d’affectivité.
La première trace d’une protestation à l’égard d’une musique moderne remonte au XIVe siècle. Elle se place dans le contexte d’une musique destinée à l’église, musique fonctionnelle s’il en est. Longtemps transmise de manière orale la musique liturgique n’a été notée qu’à partir du VIIIe siècle ; les livres qui l’ont transcrite ont été considérés dès lors comme les dépositaires de la parole divine. Comme le répertoire sacré ne pouvait être modifié, on s’est attaché à l’orner et à l’amplifier en superposant une mélodie grégorienne d’origine (les mélismes de la phrase finale d’un alleluia, particulièrement) deux ou trois voix nouvelles établies selon les règles du contrepoint naissant et dotées de textes différents. Des préoccupations esthétiques sont ainsi intervenues au sein même du chant sacré.
Aux environs de 1320 un traité manuscrit, rédigé par un musicien du nom de Philippe de Vitry, a connu une assez large diffusion. Sous le nom d’Ars nova, il proposait une nouvelle manière d’écrire la durée des notes : il introduisait des valeurs plus courtes que celles qui étaient en usage jusque là et il faisait admettre la légitimité d’une division binaire des mesures à côté des traditionnelles mesures ternaires.
Au Moyen Âge le terme ars ne renvoie pas à une esthétique mais à une technique. Cependant, cette notation nouvelle, exposée parallèlement par d’autres théoriciens, répondait à des besoins expressifs qui s’étaient manifestés dans diverses œuvres de manière confuse un quart de siècle avant sa codification. Elle permettait le développement d’une musique renouvelée dans l’esprit et se caractérisait par une grande subtilité rythmique et un goût marqué pour les dissonances. Cette musique nouvelle ne s’adressait plus seulement aux moines dans les abbayes mais à une aristocratie de cour qui avait adopté la polyphonie pour ses divertissements profanes et qui imposait ses goûts raffinés jusque dans l’église.
C’est ce qui explique la condamnation qu’en a faite le pape Jean XXII dans une décrétale de 1325, où il a rappelé fermement que la musique dans l’église ne pouvait détourner le fidèle de sa dévotion. Les pratiques nouvelles avaient ainsi fait prendre conscience aux premiers destinataires des dangers d’une valorisation de la musique pour elle-même au détriment de sa mission fonctionnelle. La polyphonie qui était née dans l’église a pourtant continué à s’y développer, avec des alternances de complexité et de simplicité relative. Elle a certes servi de culte, mais elle en a été un ornement somptueux qui devait aussi montrer la gloire du prince et la gloire de l’Eglise elle-même. Celle-ci a non seulement permis mais le plus souvent encouragé le décor sonore esthétique qu’apportaient les motets et les messes polyphoniques.
Un des grands théoriciens du XVe siècle, Jean Tinctoris, compositeur brabançon qui a vécu à Naples, après avoir écrit « la musique rend plus belles les louanges à Dieu », a dit aussi qu’elle « donne la gloire à ceux qui en sont experts », c’est à dire aux compositeurs ; c’est donc que dès ce moment, une place importante était accordée à l’individualisme créateur dans la musique. En fait de création musicale les hommes de ce temps ne connaissaient que la musique qui leur était contemporaine ou celle d’un passé récent. Tinctoris ne connaissait rien de Guillaume de Machaut, de Landino ou de Ciconia. Vers 1480 il écrivait que c’était Guillaume Dufay, mort une vingtaine d’années auparavant, qui avait fait sortir la musique du désordre et de l’incohérence et qu’un art véritable et de qualité n’existait que depuis Jean Ockeghem à la génération suivante.
Dans la pratique quotidienne, on reléguait sans cesse dans l’oubli ce qui était passé de mode ; de génération en génération on corrigeait le point de départ, en ramenant chaque fois le début de la renaissance à une distance chronologique que l’on maîtrisait par la mémoire. On choisissait un musicien dont les œuvres n’étaient plus guère chantées mais qui avait été célébré antérieurement et dont le nom était encore connu. Le musicien auquel on attribuait le mérite de la renaissance de la musique après un passé obscur variait donc : après Dufay, Ockeghem a tenu sa place ; l’ars perfecta a ensuite été représentée par Josquin Deprez, puis par Adrien Willaert, puis par Palestrina et Roland de Lassus.
L’idée d’un développement naturel de la musique est implicite dans la pensée des XVe et XVIe siècles : après une époque très faste, mais très lointaine, un âge d’or qui peut être situé dans l’Antiquité des philosophes ou des Pères de l’Eglise, la musique est entrée dans une longue période de décadence, disait-on ; elle y a été maintenue jusqu’à ce qu’un maître exceptionnel la tire de ses ténèbres et la fasse renaître ; on atteint la maturité à la génération suivante grâce à un autre maître, plus grand que le premier, qui mène l’art à sa perfection et qui est pris pour modèle par d’autres artistes ; mais déjà, on s’inquiète, car des « musiciens modernes » proposent de nouvelles manières d’écrire menaçant de mettre à mal la perfection qui avait été atteinte. Dans l’ignorance où l’on était de la musique de plus d’un demi-siècle, les théoriciens et pédagogues ont ainsi tracé pas à pas l’évolution d’une musique qui se transformait tout en restant fidèle à certains principes essentiels.
Aux XVe et XVIe siècles, un même type d’écriture, la polyphonie, s’était imposée dans tous les genres profanes et sacrés. Sans doute, celle-ci avait-elle connu des variantes, mais l’écriture contrapuntique à la base de toute création, avait assez de souplesse pour permettre à des tendances hétérogènes de se manifester, particulièrement dans le domaine profane.
A la fin du XVIe siècle cependant, les principes mêmes de la création polyphonique ont été suspectés. Les critiques les plus vives au contrepoint ont été formulées dans des milieux humanistes italiens qui allaient puiser leurs arguments dans le mythe d’une musique grecque antique qu’ils ne connaissaient que par les écrits des philosophes. Pour traduire les sentiments avec intensité, pour pénétrer l’âme des auditeurs, la musique devait, plaidaient-ils, renoncer à la polyphonie et recourir à la simple monocodie accompagnée d’instruments. En fait, au sein même de la technique du contrepoint, une des tendances de l’évolution avait déjà simplifié progressivement le contrepoint et centré l’attention de l’auditeur sur une voix en solo, les autres parties étant ramenées à des accords de soutien ; la voix en solo pouvait, en effet, atteindre une vérité plus intense dans l’expression.
Le « stile nuovo » a permis la naissance de l’opéra, un genre où ont été exploités toutes ses possibilités expressives, car il permettait de faire ressentir les passions dans toute leur violence et leur diversité. Cependant, il ne s’est pas borné à la forme exaspérée de l’opposition au contrepoint qu’était le récitatif totalement asservi au texte. En devenant « musique baroque » il a conservé des éléments stylistiques qui provenaient de l’époque précédente, mais les a renouvelés et vivifiés ; il s’est progressivement enrichi et est devenu véritablement une autre musique, profondément différente de celle de la Renaissance par son allure mélodique, son rythme, ses principes harmoniques. Il s’est consolidé en établissant au fil des œuvres le système tonal dont Jean-Philippe Rameau allait théoriser les principes dans son Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels en 1722.
Au XVIIe et au XVIIIe siècle la création musicale est restée essentiellement fonctionnelle : il y avait une musique pour l’église, une musique pour l’intimité (la musique de chambre) et désormais une musique proposée à un public qui payait sa place (l’opéra et bientôt le concert) ; ces différents rôles entraînaient une diversité d’écriture. Le compositeur travaillait pour un commanditaire, un patron, et veillait à répondre à ses attentes. Son apprentissage reposait sur l’imitation des œuvres qui lui étaient proposées comme modèles ; c’est ainsi qu’il apprenait toutes les règles de la composition, le contrepoint et la basse continue, les procédés rhétoriques de représentation des émotions, les formes et, par une pratique personnelle, le bon usage des instruments et de la voix.
Au-delà de l’apprentissage, l’imitation et parfois le décalque d’œuvres existantes étaient considérés comme un procédé légitime de composition, pour autant que l’œuvre nouvelle soit jugée bonne, c’est-à-dire soit à la fois proche de ses modèles, et quelque peu différente. On a pu ironiser sur les centaines de concertos de Vivaldi et de ses contemporains conçus sur un même modèle, inventifs chez certains, stéréotypés chez beaucoup d’autres. Cette banalisation de la création n’empêchait pas l’artiste de mettre parfois les règles en question, mais c’est en oeuvrant qu’il arrivait à le faire, comme entraîné par une dialectique interne. J.-S. Bach lui-même est souvent parti dans ses compositions d’œuvres préexistantes (écrites par d’autres ou par lui-même) ; il les transformait en les transcrivant. Dans sa musique instrumentale aussi bien que vocale, il recourait constamment à des formules mélodiques imageantes selon une rhétorique traditionnelle. Les quelques brouillons de lui qui ont été conservés montrent qu’il commençait par noter la séquence mélodique qui allait servir de base à la composition – dans une fugue, le sujet et le contre-sujet – ainsi que l’emplacement des modulations. En partant de ce qu’il avait intériorisé des modèles qu’il empruntait, selon les cas, à la musique italienne, la musique française ou la tradition allemande, il rédigeait ensuite l’œuvre d’une traite en respectant le plan initial, mais en y introduisant des innovations de détail et en y ajoutant des compléments qui pouvaient être importants.
Pour beaucoup de ses contemporains, ce qu’écrivait alors le vieux Bach relevait d’un style dépassé – c’est aujourd’hui que l’on parle de la modernité permanente de sa musique – tandis que ses fils Carl Philip Emanuel et Johann-Christian contribuaient par leurs œuvre aux changements d’écriture et du goût. En effet, dans l’évolution générale, à l’intérieur d’une esthétique donnée apparaissaient périodiquement des œuvres qui, au fil des années, multipliaient les exceptions aux règles admises ; ainsi s’élaborait progressivement un style nouveau qui finissait par reléguer dans l’oubli le précédent avec tout son répertoire : en l’occurrence le style galant allait remplacer le baroque.
Quelques philosophes comme Kant ou Schelling ont alors perçu des changements dans l’état d’esprit de certains artistes : ceux-ci rejetaient le principe de l’imitation qui avait prévalu jusque là dans les arts (imitation de la nature, des sentiments, du langage parlé) ; une nouvelle catégorie esthétique, l’originalité, a commencé alors à prendre de l’importance. En musique ce nouvel état d’esprit s’est marqué, par exemple, chez Mozart lorsqu’il a rompu avec son maître, l’archevêque de Salzbourg, et qu’il est devenu un musicien indépendant, gagnant sa vie en jouant ses concertos pour piano dans des concerts payants, en donnant des leçons, en vendant ses œuvres à des éditeurs, en fournissant des opéras à des directeurs de théâtre. A partir du moment où il a acquis une autonomie sociale, Mozart a liberté la plus grande partie de sa musique de toute fonctionnalité ; sans rompre avec les formes et les genres traditionnels, il les a amplifiés, leur adonné des accents expressifs nouveaux ; l’irruption de l’inattendu au milieu du déjà connu est chez lui l’essence de l’originalité ; il composait pour sa propre satisfaction et pour l’admiration des « connaisseurs » comme Joseph Haydn à qui il a dédié six de ses plus beaux quatuors.
L’esprit de la Révolution française a aussi insufflé un désir d’autonomie chez les artistes ; ils y ont souvent été contraints, du reste, car en France, et bientôt aussi en Europe, les anciens commanditaires – les églises, les princes – n’ont plus eu les moyens d’entretenir des musiciens et d’en être les mécènes. L’autonomie acquise par les artistes les a incités à rechercher l’originalité et celle-ci est bientôt devenue la norme pour la création.
Beethoven est alors devenu la figure mythique du musicien libéré de toute entrave sociale, qui ne visait à satisfaire que sa seule conscience d’artiste ; il a rendu son langage de plus en plus complexe : ses dernières sonates pour piano et ses derniers quatuors mènent à un monde sonore auquel n’ont accédé longtemps que de rares élus. Après lui, et inspirés par son exemple, des créateurs ont engagé leur musique dans un langage d’une complexité croissante et ont pris les risques d’une rupture avec un public qui s’élargissait grâce aux progrès de l’instruction et de la démocratie. Mais les nouveaux venus à la culture avaient de la musique une connaissance moins intime que ceux qui par tradition familiale et de longue date, avaient régulièrement vécu avec elle.
C’est souvent parce que ces amateurs ne trouvaient pas leur plaisir dans les musiques nouvelles qu’ils se sont tournés vers les musiques du passé. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle encore, la connaissance qu’on avait du passé de la musique était restée très limitée. Les premières histoires générales expliquaient que la musique avait connu un progrès constant à travers les âges et avait sans cesse gagné en qualité. En 1789, dans une des premières histoires générales écrites alors, Charles Burney écrivait encore : « Si nous avons donné dans ce livre beaucoup d’exemples d’œuvres anciennes, ce n’est pas comme modèles de perfection, mais plutôt comme des reliques barbares qui montrent les égarements de l’humanité qui a pu se contenter d’une mauvaise musique avant d’en entendre de la bonne ».
En Angleterre des « festival Haendel » consacrés au Messie ont été organisés chaque année dans les principales villes après la mort du compositeur. En Allemagne la musique de J. S. Bach qui à sa mort ne correspondait plus au goût galant alors dominant, a été valorisé par un groupe très restreint d’admirateurs comme le modèle d’un art sérieux et grave qui s’opposait aux frivolités contemporaines et ne pouvait être laissé dans l’oubli. Bach et Haendel ont ainsi été les premiers piliers d’un « musée de la musique » où ils ont bientôt été rejoints par « les trois classiques viennois », Haydn, Mozart, Beethoven et un polyphoniste comme Palestrina, qu’on n’avait pas cessé de chanter à l’église mais que désormais on allait entendre parfois dans des Concerts historiques. Ce sont les œuvres de ces maîtres qui ont fourni le noyau de ce qu’on a appelé la « musique classique ». On a jugé alors qu’il était faux de croire qu’en se transformant au fil des siècles, la musique avait nécessairement progressé en qualité ; on a pensé que des œuvres d’un passé plus ou moins lointain pouvaient apporter à l’auditeur des satisfactions plus grandes que les musiques contemporaines.
Au sein de la musique savante, la « musique classique » s’est ainsi installée en opposition à la « musique moderne » avec des œuvres qui, fonctionnelles à leur origine, ont été écoutées désormais en concert : c’est au concert et non à l’église que les cantates et les Passions de Bach ont été entendues (c’est aussi directement au concert que Beethoven a destiné sa Missa solemnis). Le répertoire classique s’est étendu, d’une part à des musiques antérieures à Bach, d’autre part à des romantiques comme Schubert, Chopin, Schumann, puis progressivement à des œuvres de compositeurs qui avaient plus profondément transformé le langage comme Wagner, Debussy, le Stravinsky de Petrouchka et du Sacre du printemps et qui, pour cette raison, avaient d’abord été étiquetés comme « modernes ».
Tous les compositeurs du XIXe siècle n’ont pas eu l’ambition de transformer le langage. Beaucoup ont écrit une musique de bonne ou de moins bonne qualité qui tenait compte, avec un retard plus ou moins grand, des acquis progressifs dans l’innovation. D’autres encore ont souhaité satisfaire les goûts du public le plus large et ont commercialisé leur art. Au XIXe siècle, ce fut le cas notamment pour les virtuoses du piano ou du violon, pour beaucoup de compositeurs d’opéra et de musique de salon.
A la veille de la première guerre mondiale, la modernité a connu des manifestations éclatantes qui ont provoqué de véritables scandales. Le Sacre du printemps de Stravinsky, vite intégré cependant au patrimoine des chefs-d’œuvre malgré ses violences rythmiques, et Pierrot lunaire d’Arnold Schoenberg, déclamé sur la traduction allemande de poèmes d’Albert Giraud, étaient apparus comme les créations les plus révolutionnaires qu’on ait jamais connues. A propos de Schoenberg, Claude Debussy, qui avait personnifié l’audace, avait écrit dans une lettre de 1915 à Stravinsky quelques phrases, inspirées aussi par le climat de la guerre, qui comptent parmi les plus véhémentes contre une musique moderne : « Il faudra ouvrir les yeux et les oreilles lorsque le bruit nécessaire du canon laissera la place à d’autres sons… Il faudra nettoyer le monde de cette mauvaise semence, il faudra tuer ce microbe de la fausse grandeur organisée, dont nous ne nous sommes pas toujours aperçus qu’elle était simplement de la faiblesse. Dans ces dernières années, quand j’ai senti les miasmes austroboches s’étendre sur l’art, j’aurais voulu avoir plus d’autorité pour crier mon inquiétude, pour avertir des dangers vers lesquels nous courions sans méfiance » (1)
Après la guerre, à l’occasion de l’audition à Paris de Pierrot lunaire, le critique Emile Vuillermoz a bien situé le rôle mythique attribué à Schoenberg comme parangon de l’avant-garde dans les surenchères de la modernité : « Lorsqu’un jeune compositeur, français ou étranger, manifestait quelque tendance pour un style heurté, fragmenté, âpre et dissonant, on disait d’un air entendu : « Il est très influencé par Schoenberg ». Pour beaucoup d’honnêtes gens, la course à la dissonance se contrôlait de la façon suivante : Wagner, jadis grand champion, s’était laissé dépasser par Debussy ; Debussy avait été distancé par Ravel ; Ravel avait été « semé » par Stravinsky ; et au-delà de Stravinsky, très loin, là-bas, dans la direction du Prater, galopait éperdument ce coureur fantôme Arnold Schoenberg » (2).
Cependant, dès ce moment, Schoenberg avait jugé qu’après le chromatisme wagnérien de Tristan et Isolde, la multiplication de modulations vagabondes auxquelles recouraient beaucoup de compositeurs avait réduit à l’inefficacité les vertus d’articulation et d’unification du langage tonal et que celui-ci, dès lors, avait fini de jouer son rôle historique : il l’a remplacé par une méthode de composition basée dans chaque œuvre sur l’organisation systématique des douze sons de l’échelle chromatique, sans aucune prédominance hiérarchique.
En Europe occidentale, en France, en particulier, Schoenberg a toujours été considéré comme un musicien d’avant-garde mais, en même temps, comme un « musicien de laboratoire ». Dans l’entre-deux-guerres, le néo-classicisme de Stravinsky a dominé la musique contemporaine. Mais, après 1945, ce néo-classicisme a été la première cible d’une nouvelle génération avec Pierre Boulez à sa tête. Ces musiciens ont répudié les structures tonales et ont adopté l’écriture sérielle, d’abord appelée « dodécaphonique », en prenant comme point de départ non Schoenberg mais son disciple viennois Anton von Webern, dont la musique, dépourvue de toute rhétorique traditionnelle, était jugée plus adéquate à l’innovation dans la rigueur. Par des rencontres aux cours d’été de Darmstadt, où pendant quelques années de jeunes musiciens de tous les pays ont rivalisé d’audace dans leurs créations, et aussi grâce aux festivals et concerts spécialisés qui ont été créés à travers l’Europe, une véritable internationale de l’avant-garde s’est alors constituée.
Ces musiciens ont affiché leur mépris pour les compositeurs qui perpétuaient de quelque manière l’usage du système tonal : après Stravinsky, ils ont bientôt condamné Bartok et même Alban Berg et Schoenberg, trop liés au passé à leurs yeux, tandis que leurs adversaires proclamaient que la pensée sérielle, en négligeant les universaux psychologiques fournis par la nature, renonçait à toute communicabilité. Les musiciens sériels ont voulu créer un style collectif rigoureusement déterminé par une logique interne. Ils ont cherché l’appui dans l’électro-acoustique pour créer des sons nouveaux et, plus tard, dans l’informatique pour élaborer des schémas de composition rigoureusement rationnels qu’il n’y avait plus qu’à traduire ensuite en matière sonore. Pendant une quinzaine d’années, le radicalisme le plus intransigeant a prévalu. D’abord solidaires, les chefs de file du sérialisme, Pierre Boulez en France, Karlheinz Stockhausen en Allemagne, Luigi Nono en Italie, Henri Pousseur en Belgique, ont ensuite poursuivi leurs démarches créatrices personnelles en évitant le plus souvent les pièges de la surdétermination et ceux de l’aléatoire ou du n’importe quoi.
Célestin Deliège a consacré récemment un gros livre à « Cinquante ans de modernité musicale » dans la deuxième moitié du XXe siècle (3), c’est-à-dire de l’avènement du sérialisme à son éclatement dans des chemins qui s’entremêlent, à ses prolongements chez de nombreux compositeurs et à ses reniements. A lire cet ouvrage, on constate que, contrairement à ce qu’avaient espéré ses initiateurs, le sérialisme ne s’est pas imposé comme un mouvement fédérateur qui indiquerait de manière incontournable le destin de la musique ; de nombreux courants ont marqué des ruptures successives dans le sérialisme et ont donné à la musique des orientations fort différentes.
Au sein de l’avant-garde même, des musiciens qu’on a dits « post-modernes » sont apparus à partir de 1970. Ils ne croyaient plus que les musiques modernes d’aujourd’hui seraient la musique universelle de demain ; ils n’ont pas craint de mélanger les styles et les genres ; ils se sont souvent inspirés des musiques du passé, de musiques extra-européennes et parfois de musiques commercialisées. Les avatars du sérialisme ne couvrent évidemment pas toute la musique contemporaine ; beaucoup de compositeurs ont continué sans trouble de conscience à écrire leur musique dans la tradition de l’écriture tonale et les musiques du passé sont restées plus que jamais dominantes.
Bien entendu, toutes les musiques – classiques et modernes – sont défonctionnalisées. Ce ne sont pas seulement les musiques modernes qui sont d’accès difficiles. En effet, pour comprendre Bach, Beethoven, Wagner ou Debussy, l’auditeur peut s’appuyer sur certaines constantes du système tonal établi depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, mais il doit aussi pouvoir distinguer dans toutes leurs variantes les schèmes formels et expressifs introduits au fil de l’histoire et, à chaque œuvre novatrice, il doit s’efforcer d’ajuster ses facultés de compréhension. Ces exigences font que toutes les musiques classiques sont élitaires, elles ne touchent qu’un public minoritaire ; les musiques contemporaines, et parmi elles les musiques modernes, n’atteignent qu’une fraction réduite de ce public minoritaire.
Dans l’étude qu’il a consacrée à la musique de J.S. Bach et à sa compréhension, le philosophe et esthéticien Boris de Schloezer écrit : « J’ose affirmer que dans une salle de concert, sur cent personnes, il n’y en a pas dix peut-être qui soient capables d’écouter réellement la musique. Convaincu qu’il lui prête attention et s’en délecte, l’auditeur généralement se contente de s’écouter ou plutôt de s’abandonner à une vague euphorie, à la fois sentimentale et sensuelle, traversée d’émotions fugaces qui le surprennent lui-même lorsque brusquement il lui arrive d’en prendre conscience et de reconnaître jusqu’où l’art a entraîné ses rêveries » (4).
Pour Boris de Schloezer, le bon auditeur doit aussi s’investir intellectuellement dans l’écoute des musiques pour les saisir dans leur globalité et leur unité. Mais, il en est conscient, même pour les musiques classiques cet idéal n’est atteint qu’exceptionnellement. La compréhension d’une œuvre moderne est plus ardue encore dans la mesure où le langage et la forme refusent les stéréotypes. Certes le temps du radicalisme intégral est passé. Les compositeurs d’aujourd’hui s’efforcent dans leurs œuvres de susciter l’attention de l’auditeur par des points d’ancrage qui créent des alternances et des oppositions de divers types. Ils ont l’espoir que l’auditeur pourra ainsi, sans en prendre véritablement conscience, percevoir les éléments d’une forme et donner un sens psychologique à ce qu’il entend. Cet espoir leur donne une raison de créer et même de vivre. Mais il faut le reconnaître, il n’est pas souvent satisfait.











