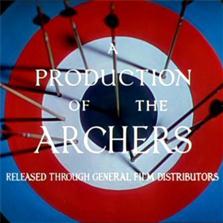De la figure de la chute

A première vue, tout semble évidemment renvoyer à l’idée de chute selon la logique du récit d’Icare – cette tentative avortée de vol, cette brûlure solaire. Dédale, emprisonné avec son fils Icare dans son propre labyrinthe, fabrique deux paires d’ailes pour s’en échapper et lui recommande de ne pas s’approcher du soleil au risque de perdre ses ailes, une fois la cire fondue. « Tous les deux s’élevèrent donc, légèrement et sans effort, et quittèrent la Crète ; le ravissement de ce nouveau et merveilleux pouvoir grisa l’adolescent. Il monta de plus en plus haut, refusant d’entendre les appels angoissés de son père. Et ses ailes se détachèrent. Il tomba dans la mer et les eaux se refermèrent sur lui. » (1). Envol, élévation, ravissement, chute. Chute des corps en écho à une faillite édénique et morale, inspiration de nombreux écrivains et peintres. Pourtant, si elle est l’élément marquant le point de basculement dans le récit mythologique (ou biblique), la chute ne se présente pas comme synonyme unique de damnation – comme le souligne Christine Buci-Glucksmann, « la chute d’Icare n’est pas celle des damnés. Elle ouvre plutôt à cette poétique du vol et de l’envol, à un ‘psychisme ascensionnel’ nietzschéen » (2).
La chute est aussi, rarement et paradoxalement, représentation du mouvement. Gaston Bachelard en 1943 déplore ainsi la rareté des impressions dynamiques de la chute ; selon lui, « la chute ‘pure’ est rare », puisque, au contraire de Lucifer qui tomba pendant 9 jours dans le Paradis Perdu de Milton, la brièveté de la chute ne s’appréhende que par l’imagination à quelques exceptions picturales près comme les représentations du mythes de Carlo Saraceni ou La chute d’Icare par Pierre Paul Rubens (1604-1605) (, celles de Domenico Piola (1670) (, Antoine Van Dyke ( ou Frédérick Leighton (1869) ( montrant la préparation, celle de Herbert James Draper (Lamentations for Icarus, 1898) ( dévoilant le corps inanimé ou, comme chez Pieter Breughel l’Ancien en 1558 (, déjà presque englouti dans les eaux et perdu au milieu du tableau (3).

| 6 images | Diaporama |
Représenter la chute comme figure du ‘psychisme ascensionnel’ et de la ‘dynamique du mouvement’ semble donc relever d’une double contrainte. C’est, à notre sens, l’ambition de Michael Powell dans quelques-uns de ses films.
Powell/Pressburger ou « les archers »

Michael Powell, au nom définitivement associé à celui d’Emeric Pressburger, occupe une place à part dans l’industrie anglaise du cinéma, une place pratiquement antithétique vis-à-vis des productions qui leur sont contemporaines ; ils parviennent à réfuter la fameuse phrase de François Truffaut qui déclarait une certaine incompatibilité entre les mots cinéma et anglais. L’esthétique de Powell est unique ; née d’une fusion avec son acolyte Pressburger, elle répond à la fois aux formes du réalisme, au drame socialement conscient et à la tradition documentaire qui font la plus grande partie du cinéma anglais tout en s’engageant dans une forme (le mélodrame) et une esthétique (grandement artificielle qui renforce l’escapist fantasy) spécifiques. La nature hybride et mixte de ces films plonge souvent les critiques dans le désarroi ou l’incompréhension.
Né en 1905 dans le Kent, près de Canterbury, Powell a travaillé à partir de 1922 dans l’industrie anglaise avec Rex Ingram, Léonce Perret, Alfred Hitchcock, Lupu Pick et en tant que réalisateur de « quota quickies » dans les années 30. Il a choisi le cinéma à l’âge de 16 ans, et son histoire y est liée (‘I am simply cinema’). Né en 1902 à Miskolc en Hongrie, Pressburger, d’origine juive et hongroise, a étudié dans les universités de Prague et Stuttgart, et a travaillé comme scénariste dans les studios allemands de la UFA (dans les années 30), mais aussi en France, avant de venir en Angleterre pour fuir le nazisme ; il débarque en 1935, et a déjà travaillé pour Korda qui lui demande de faire des réécritures pour des films. 1939 (The Spy in Black réalisé pour le producteur d’origine hongroise, Alexander Korda), puis 1940 (Contraband marque leur deuxième collaboration, toujours pour Korda) voient l’avènement de leur premier film commun qui va marquer le cinéma britannique jusqu’en 1957, date d’arrêt de leur compagnie de production « The Archers ». Leur période la plus prolifique et artistiquement la plus développée s’étend de 1943 à 1950 avec The Life and Death of Colonel Blimp (43), A Canterbury Tale (44), I know where I’m going ! (45), A Matter of Life and Death (46), Black Narcissus (47), The Red Shoes (48), Gone to Earth (50) (19 films au total, sans compter les simples productions et les courts métrages). En 1942, ils adoptent une signature conjointe de scénariste/producteur/ réalisateur sur leur film One of Our Aircraft ; en 1943, ils créent leur propre maison de production, « The Archers Film Production » et adoptent un logo montrant une cible avec une flèche qui sera celui de tous leurs films (jusque 1957). Suit la mention « Written, produced and directed by Michael Powell and Emeric Pressburger » qui indique leur responsabilité conjointe pour leur travail et leur indépendance vis-à-vis de tout studio ou producteur extérieur. Dans une lettre adressée à Deborah Kerr afin de la convaincre de jouer dans The Life and Death of Colonel Blimp, ils instaurent des commandements – fétiches de leur intégrité. C’est ce qui transparaît dans certains des points repris, notamment « Chaque élément de film est de notre propre responsabilité et de celle de personne d’autre. Nous refusons d’être guidés ou forcés par aucune influence si ce n’est notre propre jugement ».
La chute - métaphore du mouvement

On a souvent commenté le trajet de la flèche instrument-clé du logo de la maison de production « The Archers » (. Mais jamais semble-t-il, la chute, thème omniprésent dans les réalisations de Powell, n’a été envisagée comme autre métaphore du mouvement filmique et d’arrêt subit. A l’observer de plus près, si la chute est facilement établie comme un élément fondamental de la filmographie de Powell et si certaines constantes s’y retrouvent, il faut, en réalité, se plier à l’hypothèse d’une multitude de chutes possibles, démultipliée par les angles et les trajectoires personnelles de chaque personnage qui vit cette attraction verticale. Elles peuvent être anecdotiques, de l’ordre de la « practical joke » comme au début de A Canterbury Tale (1944) avec la chute du pèlerin poussé par l’un de ses congénères, ou au début de Colonel Blimp (1943) lorsque des soldats tendent une corde pour ‘piéger’ un des messagers à moto. Elles deviennent essentielles et fatales dans les grands mélodrames que sont The Red Shoes (1948), Black Narcissus (1947) ou encore Gone to Earth (1950) (4).
La chute répond ainsi à un principe de prédestination au gré des lieux et des signes – la chute est préparée, voire répétée avant d’avoir effectivement lieu ; le corps qui chute est un corps ‘toujours-déjà-tombé’. La répétition marque le rôle du destin dans lequel sont empêtrés les personnages qui ne peuvent finalement suivre qu’une seule voie toute tracée. Elle se nourrit également des figures rhétoriques du genre mélodramatique – hyperbole et antithèse – pour mieux servir l’idée, reprise par Peter Brooks que, dans le mélodrame, « tout doit être sublime » (5). Enfin, selon l’idée de ‘psychisme ascensionnel’, la chute devient le nœud de l’oxymore final – réconciliant l’irréconciliable, l’attraction simultanée du haut et du bas, la descente et l’envol.
Topos et trajectoires

La chute, son mouvement et son récit, s’inscrivent d’abord, logiquement, dans une topographie des lieux. Comme l’a souligné John Russell Taylor, la nature dans les films de Powell n’est jamais l’impassible théâtre des passions humaines mais un participant particulièrement actif (6). Le lieu est ainsi à la fois le témoin et l’instigateur du drame qui se prépare ; les chutes ne sont en effet rendues possibles que dans ces paysages extrêmes, possibles points de rupture d’un univers. Powell situe ses intrigues aux confins du monde terrestre ou même de la civilisation, comme si la terre n’était finalement pas ronde, mais bien plate et sujette à une loi d’un arrêt subit. Comme si le lieu imposait entre lui et les êtres humains qui y déambulent une ligne de démarcation invisible au-delà de laquelle la chute est inévitable. Ainsi, les montagnes, les paysages aux reliefs imposants, les phares, lieux de l’entre-deux monde (la terre et la mer), sont présents dès les premiers films de Powell, de The Phantom Light (1935) à I know where I’m going (1945).
Mais au-delà des phares, ce sont les falaises, autres lieux limitrophes, dont ils protègent les bateaux dans la nuit et la tempête qui sont l’emplacement idéal du déchirement entre la terre et un au-delà inaccessible comme le démontre si bien The Edge of the World (1937), film au titre singulièrement emblématique . Ultime rempart entre le ciel et la terre, viennent ensuite les cimes de l’Himalaya où emménagent les nonnes du Black Narcissus (source d’un enivrement visuel et charnel constant qui provoquera les vertiges) auxquelles il faut rajouter les peintures murales décrivant le Harem qui annoncent déjà la chute (Fig. 10 & 11). La représentation plastique de ces endroits, décors de studio ou décors naturels mais transfigurés par les contrastes noir et blanc ou les excès chromatiques d’un Technicolor flamboyant supervisé par Nathalie Kalmus et appliqué à la photographie de Jack Cardiff, tient évidemment de la même logique des limites puisque, comme le précise Vincent Amiel, « il s’agit de donner corps à des passions déraisonnables, à des situations dramatiques extrêmes » par l’utilisation de la forme (7).

| 2 images | Diaporama |
L’ascension physique reflète l’évolution du personnage – mais elle ne s’établit que dans un système d’antithèse à la trajectoire. Pour Deleuze, « une structure est le dessin d’une trajectoire, mais une trajectoire n’est pas moins le tracé d’une machine » (8). Dans cette optique, l’arrivée au sommet est la plupart du temps précédée d’un voyage, qui peut se faire sous différentes formes, en privilégiant toutefois le véhicule à trajectoire directe, voire protensive – le train ; si les sœurs du Black Narcissus se déplacent à dos d’âne, que les pèlerins de Canterbury Tale le font à cheval, dans The Phantom Light, le nouveau gardien du phare débarque du train, l’héroïne de I know where I am going voyage en train vers son mariage (Fig. 12-15), et Vicki Page dans The Red Shoes parcourt l’Angleterre et la France par rail avant d’arriver à Monte Carlo. Une fois le voyage entamé, la trajectoire horizontale se prolonge alors en trajectoire verticale ascendante, marque évidente et symbolique d’une ascension morale, psychologique, sociale ; cette géométrie des trajectoires se lit comme la matérialisation des destins des personnages. Les corps sont soulevés, élevés à bout de corde (The Edge of the World). Les escaliers se démultiplient, succèdent à des routes ascendantes, des corniches qui mènent à des lieux élevés, comme dans The Red Shoes où Vicki, fraîchement débarquée à Monte-Carlo, se rend dans la villa de Lermontov pour apprendre qu’elle aura le premier rôle du nouveau ballet (9). La vue ouverte sur la mer le confirme, le sommet atteint instaure un regard qui sera dès lors surplombant, généralement encore accentué par une prise de vue des visages en contre-plongée (Fig. 16-17).

| 4 images | Diaporama |
En écho annonciateur à cette scène, la séquence d’ouverture des Red Shoes est emblématique ; elle instaure d’emblée le système d’ascension, par la course dans les escaliers pour assister au spectacle des ballets russes à partir ‘du poulailler’, puis par le regard de Julian et Vicki qui assistent, lui du poulailler, elle de la loge, à la représentation (Fig.18). L’attraction verticale se met en place - le personnage ne peut plus regarder que vers le bas, littéralement et métaphoriquement, de façon quasi hypnotique, vers ce qui lui donne le vertige – le trajet à accomplir, ou accompli – dans lequel il se trouve, se définit et se perd à la fois.
Le rôle de la vision dans les films de Powell a souvent fait l’objet d’analyses, mais peu de critiques ou de théoriciens ont réellement souligné cette démultiplication du regard surplombant qui se retrouve dans l’ensemble de ses films, regard généralement d’une tierce personne, sur une situation critique ou emblématique (la vision du Paradis sur la terre ou encore celle de la Mère Supérieure sur les sœurs pour indiquer à Sister Clodagh qui l’accompagnera). Notons que cette position, si elle implique l’accès à une connaissance supplémentaire, ne renvoie pas à l’idée de pouvoir – ce n’est pas parce qu’ils accèdent au regard surplombant, que les personnages peuvent agir sur la situation, le cas le plus flagrant étant sans aucun doute celui des préposés au Paradis dans A Matter of Life and Death (1948) (Extrait 1). Le choix des angles, des plongées et des contre-plongées ne répond pas non plus à l’idée d’un rapport de force, mais plutôt à celle d’attraction et, comme le souligne Natacha Thiéry pour The Edge of the World, au fait d’éviter « la frontalité de l’objet filmé » (10).

| 2 images | Diaporama |
Prédestination et formes du vertige

Mais les indices topographiques ne suffisent pas. La chute est également annoncée selon une logique de prédestination mélodramatique. La chute du fils annonce en écho celle du père dans The Edge of the World sur l’île d’Hirta (la mort), la chute de Vicki Page se prépare dans son double scénique, la jeune fille aux chaussons rouges qui chute dans un décor fantasmatique avant d’atteindre les enfers puis la mort devant les marches de l’église après avoir retiré les chaussons maudits (Fig.20 & 21). Mais c’est la chute de Hazel qui s’inscrit le mieux dans cette logique de prédestination (11). De l’ouverture du film sur la chasse au renard qui disparaît sous terre au son du fameux « gone to earth » (et qui sera repris en écho à la mort d’Hazel) à la violente confrontation avec le trou dans la colline pentue (Extrait 2), en passant par l’exécution des charmes de sa mère qui doivent se faire sur la montagne, les indices, les signes se démultiplient, soulignant encore le caractère damné d’un personnage qui souffre de l’héritage de sa mère, sorcière (12). Comme Vicki Page, la danseuse systématiquement érigée sur ses pointes, comme les nonnes ancrées dans leur foi céleste, ou encore Peter David Carter (David Niven) aviateur, Hazel est prédestinée à la chute, toujours juchée sur les collines et les monts . C’est le personnage lui-même, entier et excessif, qui est intrinsèquement prédestiné à la chute.

| 2 images | Diaporama |
Le rapprochement avec le regard que l’on pose vers la tombe est surprenant, induit de façon encore plus limpide par le métier de ‘faiseur de cercueils’ du père. Le regard effrayé de Hazel vers le trou est celui de celui qui y voit non pas le lieu d’un accident possible, mais bien celui de sa propre sépulture . Le vide permet dès lors de voir ce que l’on ne pouvait pas voir auparavant et qui nous regarde dans une perspective inversée. Bien évidemment, cette mise en place ne se justifie qu’en regard des personnages eux-mêmes, à la fois dans un système de miroir (en ce qui concerne les signes) ou d’opposition (en ce qui concerne les lieux). S’ils sont le point d’origine de leur perte ou de ce sentiment de basculement, les lieux de la chute ne sont finalement que l’écho des personnages mélodramatiques qu’ils mettent en scène – des personnages extrêmes, entiers, monopathiques selon le terme de Robert Heilman, contrairement aux personnages tragiques qui sont, eux, déchirés de l’intérieur (13). Le double de Vicki Page, une statue en pierre d’une femme ailée qui répond au registre des signes mélodramatiques de Brooks, garde les fenêtres de la villa de Lermontov et semble fixer le vide qui s’étend à ses pieds. Hazel trouve dans le trou une forme de miroir de sa propre mortalité. Clodagh et les autres nonnes trouvent dans les gouffres vertigineux le lieu de leur mémoire sensible, de leur transport physique et mental.
Dans son livre Edge of the world-The Making of a Film, Michael Powell décrit son arrivée sur l’île de Foula où il décide de tourner : « Cela ne sert à rien de dire que cela me coupa le souffle car cela arriva une centaine de fois lors de ma première visite à Foula. Je peux juste décrire ce que j’y ai vu. Il y avait un potager à salade qui courait jusqu’au mur où il y avait un petit pont. Supposez que vous puissiez vous pencher sur votre mur de jardin et regarder en bas, vers 300 pieds de rocher jusqu’à Helliberg, blanc d’écume d’une vague de l’Atlantique, puis brun pendant que la vague se retire dans la mer, de nouveau blanc, puis brun à nouveau, blanc, … brun jusqu’à ce que votre œil soit hypnotisé; supposez que vous puissiez voir cela, ça pourrait être mauvais pour vos salades, mais bon pour votre âme” (14). Ce n’est pas la chute en soi qui est mise en avant dans la description de Powell, mais bien la sensation ainsi que le rapport hypnotique qui s’imposent lors du vertige. La proximité et la distance combinées, mais aussi la myriade de sensations synesthésiques qui précipitent la dissolution du sujet dans le milieu qui l’entoure.
Selon Danielle Quinodoz, au-delà des troubles de systèmes sensoriels, il existe non pas un vertige mais plusieurs formes de vertige d’origine psychique qui reflètent les pathologies de la relation (15). Hazel semble ainsi souffrir du « vertige par attirance du vide » qui s’amorce lors du processus de différenciation entre l’individu et l’objet pendant lequel la distance s’instaure entre les deux, créant un vide extérieur qui est perçu au travers d’une projection du sentiment de vide intérieur. Le « vertige par expansion », particulier aux alpinistes et, métaphoriquement, à Victoria Page, s’articule sur le désir d’expansion du moi à ses limites dans l’espoir de se sentir exister – Victoria ne se met littéralement à vivre que lorsqu’elle danse comme le laisse entendre sa réplique à Lermontov quand il lui demande pourquoi elle veut danser (« pourquoi voulez-vous vivre ? »). Par contre, le cas des nonnes du Narcisse noir illustre celui du « vertige par fusion », à savoir la relation fusionnelle d’un individu avec un objet qui rejette la mise à distance entre les deux, provoquant un sentiment d’anéantissement et d’engloutissement de cet objet.
« Je pense que l’on peut voir trop loin » (Fig. 24) (Extrait 3) - l’idée de dissolution dans la chute fait écho au désir de choir. Se défaire de la matière et des traces laissées par l’installation dans cette Maison des femmes où la chair est prégnante par, notamment, les peintures murales qui renvoient silencieusement mais avec insistance au passé luxurieux du lieu. S’abandonner et se perdre, à la fois dans les sensations mais aussi dans les souvenirs, comme Sister Clodagh qui se revoit en Irlande. Seule Sister Philippa semble pouvoir exprimer son trouble, par deux fois, victime d’un trop plein de matière, assaillie d’odeurs, de couleurs, de sensations réprimées jusqu’alors et que le paysage lui impose ; son discours au passé témoigne de cet engloutissement – « J’étais trop attachée à l’endroit. J’étais trop engagée dans mon travail. J’y pensais trop. J’avais oublié… ce que j’étais” (16). Powell ne se contente pas par ailleurs de représenter les troubles que subissent ses personnages, il tente également de les imposer au spectateur, le précipitant dans le vertige des sensations visuelles, tactiles voire olfactives de ses films. Il en résulte une expérience du sublime burkéen dans laquelle le sujet du regard fasciné reste à l’abri du paysage excessif.
Accélérations et chutes

Après le cheminent horizontal puis ascendant, la trajectoire se définit de manière antithétique en pliant enfin sous le poids de l’attraction terrestre et verticale; certains vertiges mènent alors à la chute des corps. Accidentelle ou délibérée, la chute se traduit visuellement, de film en film, par les mêmes indices. Elle s’inscrit dans le moment climactique du récit, au sein de l’excès des sentiments, comme une ponctuation. Hazel, à la croisée des chemins entre les deux hommes, veut sauver son double – le renard pourchassé par les hordes de chiens, Vicki ne parvient pas à choisir entre le spectacle et son amour pour Julian et devient folle, Sister Ruth, prise d’une crise d’hystérie, s’en prend à Sister Clodagh dans un acte de vengeance aveugle qui accentue encore, jusqu’au paroxysme, le déchirement entre la plongée et le regard médusé de Clodagh en contre-plongée . Déchiré entre pressions contradictoires simultanées (céder à sa nature ou à celle que l’on veut leur imposer), lieu de l’abolition de repère et d’une confusion intense, le sujet, désorienté, perd son identité. La mise en scène reflète ce déchirement, cette apocalypse intime, dans une séquence frénétique, une accélération du montage, une démultiplication des points de vue, entre le sujet de la chute imminente et les témoins de sa préparation. Mais c’est la fragmentation des corps qui est l’élément le plus signifiant et le plus insolite – Hazel et Victoria ne semblent plus se définir que par leurs enjambées affolées (Extrait 4), Ruth par ses yeux qui guettent Clodagh avant de l’attaquer .

| 3 images | Diaporama |
L’accélération cherche à rendre la violence de la chute et l’enivrement qui la précède. C’est ici, dans ce moment furtif qui se résume en un plan comme un instant volé, que l’on peut envisager cette chute comme un ravissement. Cette idée, à mi-chemin entre violence et sérénité, désigne à la fois « l’action d’enlever de force mais aussi l’état d’un esprit transporté de joie, ravi dans la béatitude », tout en situant la nature de cette action entre instances humaines et divines (17). Si l’instant semble tragique et brutal, il n’est en réalité, comme le propose le principe d’oxymore mélodramatique, que celui d’une forme de libération, d’envol du personnage vis-à-vis de ses affres terrestres : « à l’instar de la philosophie heidegerienne et de l’évolution du Dasein, il faudrait dès lors considérer cette mort non pas comme une fin en soi, mais comme un stade permettant au personnage de s’accomplir véritablement et d’être, enfin, entier » (18).
Powell montre alors le mouvement de la chute, l’instant de suspension entre le lieu du saut et le vide. Il ne fait aucun doute que Powell sert ici de précurseur, beaucoup d’artistes ayant depuis lors cherché à traduire cet instant, cette suspension, cet entre-deux ; c’est ainsi le cas du photographe américain Kerry Skarbakka (Fig.29-31) qui se capte au moment clé du basculement dans une série d’autoportraits saisissants intitulée « How to right oneself » ou encore, mais de façon beaucoup plus aérienne chez Dennis Darzacq , ou, en posant un regard rétrospectif, le saut dans le vide d’Yves Klein en 1960 . Le poids du corps disparaît ensuite, comme par magie, dans le transport (19).

| 4 images | Diaporama |
Chez Powell, comme chez d’autres, après avoir été montré dans le mouvement de la chute, le sujet s’évanouit, figure de l’absence ravie par la terre (Gone to Earth), la mer (The Edge of the World), la végétation (Black Narcissus) ou encore, comme dans un cercle infernal, engloutie par le train (The Red Shoes). Le regard cherche en vain le corps écrasé, comme dans l’exemple avancé de The Phantom Light où le traître a sauté du phare pour échapper à ses poursuivants, ou dans The Edge of the World dans lequel les vagues s’écrasant sur les rochers ou les plans du chien et de l’homme qui, silencieux, fixent le vide laissé sont les seuls indices de ‘ce qui a été’. Seul le corps de Victoria Page est montré, encore vivant, afin que le sortilège soit accompli – la mort ne venant qu’après avoir enlevé les chaussons rouges . Dans les autres exemples, c’est une fois encore le lieu qui prend le dessus, « s’éloignant des personnages humains à des moments importants pour se concentrer sur des phénomènes naturels de plusieurs sortes – un arbre, une pierre, le passage d’un nuage à travers le ciel – qui fournissent des sortes de commentaires muets sur l’action humaine, clarifiant ou intensifiant ou peut-être amenuisant et redirigeant le contenu émotionnel d’une scène » (20). A la chute, succède un instant de suspension temporelle lors duquel l’humain perd sa suprématie au profit d’une articulation panthéiste de l’univers – les vagues de The Phantom Light ou de The Edge of the World, la végétation et l’envol des oiseaux dans Black Narcissus, les collines désertées dans lesquelles retentit l’écho du « Gone to Earth » d’un chasseur, etc. L’ordre du monde est, le temps d’un instant, littéralement suspendu.
La question de la chute pose évidemment celle de ses conséquences ; exposer l’accident, c’est ‘révéler la substance’ pour paraphraser Platon. The Red Shoes et Gone to Earth se clôturent sur la disparition, l’évanouissement du personnage et l’annonce de celle-ci, Black Narcissus voit le départ des nonnes et le retour vers leur ancien couvent. Le choc se précise dans The Edge of the World, dans lequel la course entre les deux jeunes hommes et la chute accidentelle de l’un d’entre eux précipite la décision des habitants de l’île d’Hirta de quitter les lieux et d’évoluer. Mais c’est dans A Matter of Life and Death, que se dessine le basculement le plus essentiel.
Le topos est idéal (les cieux), la situation extrême (le seul rescapé d’un bataillon n’a plus que le choix de sauter), la chute amorcée, l’aviateur escamoté puis remplacé par des plans de nuages et d’océan. Cependant, un indice surprend – le corps nous est montré, exposé. Puis la narration s’instaure - contrairement aux autres récits, le film débute sur la chute…et sur l’échappée à la mort, au véritable ravissement évoqué de façon presque fantasmatique dans les autres exemples. Elle devient ainsi le point d’ancrage du dérèglement, la faille, l’accident ô combien ironique (on se souviendra que c’est à cause du ‘brouillard permanent sur l’Angleterre’ que le Ciel a raté son candidat au Paradis) qui imposera aux choses du cosmos d’être entièrement reconfigurées. La chute, donc, mais comme renouveau, comme renaissance pour provoquer le bouleversement d’un monde.
Epilogue

Si, malgré tous ces exemples emblématiques, on pourrait encore croire à un heureux hasard dans la récurrence d’une figure, la découverte de trois projets inaboutis dans les archives du cinéaste semble écarter toute hésitation (21). L’adaptation de The Tempest semble offrir, une fois de plus, à Powell la possibilité de jouer sur un topos hyperbolique – une île volcanique – qui reflète les passions qui s’y jouent. Celle de The Fall of the House of Usher d’après Edgar Allan Poe mais surtout la partition opératique qu’en a réalisée Philip Glass, contient, dans son titre et dans son intrigue, toutes les traces des enjeux de la chute mais aussi la mise en place du vertical, au travers des adjectifs qui « vivent verticalement » dans le texte de Poe selon Bachelard et qui devraient parfaitement s’illustrer dans la logique visuelle des attractions selon Powell (22).
Enfin, le plus intriguant se trouve dans un projet d’une série télévisée consacrée à des biographies de poètes en 1970. Le projet semble annoncer les « Falls » que Greenaway réalisera en 1980, par sa structuration selon les différents modes « d’élimination d’un poète » (Thirteen Ways to Kill a Poet). Dans la première série, Powell propose d’aborder entre autres Percy Byssche Shelley (par l’eau), Oscar Wilde (par la beauté), Frederic Chopin (par l’amour), ou encore Lord Byron (par le destin), il envisage également le cas de Lauro de Bosis (par les ailes). Né à Rome en 1901, il est le plus jeune fils du poète Adolfo de Bosis, traducteur de Shelley en Italie. Poète engagé, il écrit pour contrer la politique de Mussolini (après avoir été son partisan), et apprend à voler. Powell, dans son projet, décrit : « Il apprit à voler et dans l’après-midi du 3 Octobre 1931, il s’envola à bord d’un monoplace de Marignan, près de Marseille, et vola directement au-dessus de Rome. Il était l’heure qui suivait le dîner et les cafés étaient remplis lorsqu’il vola très bas au-dessus des rues, jetant des affichettes adressées au Roi et au peuple de Rome. Il s’éleva, se dirigea vers l’Ouest et on n’entendit plus jamais parler de lui (23). La chute, implicite, serait sans signification si, quatre ans avant sa mort, de Bosis n’avait écrit une tragédie poétique sur la figure emblématique de la chute.