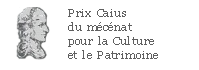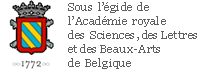FRANCAIS - ENGLISH
Peinture - Sculpture - Epoque contemporaine - France - Histoire de l'art
Marine Lagasse
Le Paratexte d’exposition de Daniel Buren
Processus d’autolégitimation dans le milieu de l’art contemporain
Amateur


Expert


Notes
 Notes
NotesNotes

| Numéro | Note |
| 1 | Gérard GENETTE, Palimpsestes, La Littérature au second degré, Paris, Éditions du Seuil (coll. « Poétique »), 1981 et Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Éditions du Seuil (coll. « Poétique »), 1987. |
| 2 | Gérard GENETTE, Palimpsestes, op.cit., pp.7-14. |
| 3 | Jérôme GLICENSTEIN, L’Art contemporain entre les lignes, Textes et Sous-textes de médiation, Paris, Presses universitaires de France, 2013. |
| 4 | Gérard GENETTE, Seuils, op.cit., p.7. |
| 5 | Jérôme GLICENSTEIN, L’Art contemporain entre les lignes, op.cit., p.3. |
| 6 | Gérard GENETTE, Seuils, op.cit., p.374. |
| 7 | Il s’agit donc de ne s’intéresser qu’aux textes d’artiste produits en accompagnement d’expositions de son propre travail plastique. |
| 8 | Louis MARIN, De l’entretien, Paris, Éditions de Minuit, 1997. |
| 9 | Le terme « institutionnalisé » désigne tout support de communication repris traditionnellement dans les expositions organisées par les institutions de l’art, les institutions publiques ou privées dont la mission consiste avant tout à la conservation du patrimoine. Leurs missions et leur déontologie sont dictées par des instances internationales reconnues telle que l’ICOM. |
| 10 | Du 3 janvier au 5 novembre 1967, Buren participe à plusieurs Manifestations au sein du groupe BMPT. Ce sigle est formé à partir des noms des quatre artistes qui le composent : Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni. |
| 11 | Mise en garde, version publiée dans le catalogue Konzeption/Conception, Leverkusen, Städtischen Museum, 14 octobre-novembre 1969, n.p., Mise en garde n°3, reprise de Mise en garde complétée, publiée dans VH101, Paris, n°1, printemps 1970, pp.97-10 et Mise en garde n°4, reprise de Mise en garde complétée, publié dans Les Lettres françaises, Paris, 17 juin 1970, pp.26-29. |
| 12 | Repères, publié dans le catalogue Daniel Buren, Position – Proposition, pour l’exposition Eine Manifestation, Mönchengladbach, Städtisches Museum Mönchengladbach, 28 janvier – 7 mars 1971, pp.5-23. |
| 13 | Fonction du musée, publié dans la catalogue Sanction of the Museum, Oxford, Museum of Modern Art, 31 mars-15 avril 1973, n.p. |
| 14 | L’intégralité de la publication Limites Critiques publiée en 1970, n.p. |
| 15 | Exposition d’une exposition, publié dans le catalogue Documenta 5, Cassel, 30 juin – 8 octobre 1972, p.29. |
| 16 | Fonction d’une exposition, publié dans Konrad Fischer, Es Malt, Düsseldorf, s.e., 1973, pp.2-6. |
| 17 | Pour la liste des republications et des traductions de ces textes, se référer, par exemple, à la bibliographie en ligne sur le site de Daniel Buren, op.cit. |
| 18 | Entre autres, Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, Paris, Flammarion / Centre national des arts plastiques (coll. « Écrire l’art »), 2012, pp.266-286 et Documenta 5, Cassel, 30 juin - 8 octobre 1972, section 17, pp.30-34. |
| 19 | Entre autres, Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, op.cit., pp.364-386 et Eight contemporary artists, New-York, Museum of Modern Art, 9 octobre 1974 – 5 janvier 1975, pp.19-26. |
| 20 | Points de vue, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 6 mai au 12 juin 1983. |
| 21 | Marine LAGASSE, Les Textes de Daniel Buren en relation avec ses expositions, Pratiques et Enjeux, Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, travail de fin d’études en vue de l’obtention du titre de Master en Histoire de l’art et Archéologie, dirigé par le prof. Denis LAOUREUX, 2015, pp.55-56. |
| 22 | Descriptif publié dans le catalogue Daniel Buren, Nagoya/Tokyo, Institute of Contemporary Arts/ Touko Museum of Contemporary Art, 15 avril – 25 juin 1989/ 28 avril – 11 juin 1989, np. |
| 23 | Descriptif de la transformation des vélums de PH Opéra, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1974-1977, voir entre autres dans : Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, op.cit., pp.1977-1980. |
| 24 | Ainsi, dans un contexte de pleine liberté en tant que commissaire, la conception de l’ouvrage Propos délibérés pour l’exposition Buren-Parmentier à Bruxelles en 1991 témoigne de cette préférence. |
| 25 | Les Avertissements, datant de 1972, sont l’équivalent des anciens certificats d’acquisition des œuvres de Daniel Buren ou contrats de vente comme les appelle Sophie Gayet. Sophie Gayet, « Les Avertissements de Daniel Buren, la Menace du faux », in La Voix du regard, n°14, automne 2001. |
| 26 | Daniel Buren a réalisé, à ma connaissance, un mode d’emploi (hors du cas des Avertissements) qui est directement à destination de l’acheteur : en 2001, Art Wall Sticker vend des kits de rubans adhésifs et y joint le mode d’emploi de l’artiste pour la réalisation de l’œuvre. Voir Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 2 : 1996-2012, Paris, Flammarion / Centre national des arts plastiques (coll. « Écrire l’art »), 2012, pp.631-632. |
| 27 | Daniel Buren parle lui-même de « faux » dans ce cas. Voir Jérôme SANS (entretien avec), Au sujet de…, Paris, Flammarion, (coll. « La Boîte noire »), 1998, p.145. |
| 28 | La retranscription de la version définitive de l’Avertissement-type, voir Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, op.cit., pp.233-236. |
| 29 | La reproduction recto-verso de l’Avertissement-type, voir Daniel BUREN, Mot à mot, op.cit., pp.A50-A51. |
| 30 | La retranscription de l’Avertissement-type, voir Anne BALDASSARI (entretien avec), Propos délibérés, Villeurbanne, Art édition, 1991, pp.160-162. |
| 31 | Il appelle cela un dispositif-œuvre ou de l’art installé. Jérôme GLICENSTEIN, L’Art contemporain entre les lignes, op.cit, pp.21-22. |
| 32 | Jérôme GLICENSTEIN, L’Art : une histoire d’exposition, Paris, Presses Universitaires de France (coll. « Lignes d’art »), 2009, p.108. |
| 33 | Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, op.cit., p.88, note en bas de p. n°1. |
| 34 | Gérard GENETTE, Seuils, op.cit., pp.7-8. |
| 35 | Le concept de performativité renvoie aux énonciations performatives théorisées par Austin. Ces énonciations, au-delà du dire, actent en réalité quelque chose : elles font une chose par le fait de le dire. John Langshaw AUSTIN, Quand dire, c’est faire, [1962], trad. par Gilles Lane, Paris, Éditions du Seuil, 1970. |
| 36 | Gérard GENETTE, Seuils, op.cit., pp.7-8. |
| 37 | Les arts allographiques ne se définissent pas dans leur seule matérialité, à l’inverse des arts autographiques. Ils sont en fait susceptibles de se renouveler selon le contexte, selon la performance ou la représentation. Jean DAVALLON, « Réflexions sur la notion de médiation muséale », in L’Art contemporain et son exposition, séminaire organisé à Paris, au Collège international de philosophie de 1999 à 2001, vol.1, Paris-Budapest-Torino, L’Harmattan (coll. « Patrimoines et Sociétés »), 2002, pp.59-61. |
| 38 | Nathalie HEINICH, L’Élite artiste, Excellence et Singularité en régime démocratique, Paris, Éditions Gallimard (coll. « Bibliothèque des Sciences humaines »), 2005, p.335. |
| 39 | Il a nommé le phénomène de « dénégation de l’économie » qui structure le champ de l’art : les agents (auteurs, critiques, marchands ou amateurs d’art) se défendent d’intérêts mercantiles. Ses études ont en fait contribué à propager une image radicalisée de l’importance économique dans le milieu artistique. Pierre BOURDIEU, « La Production de la croyance, Contribution à une économie des biens symboliques », in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 13, n°13, L’Économie des biens symboliques, 1977, pp.3-43, p.7, disponible en ligne sur Persée, http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1977_num_13_1_3493, dernière consultation le 12/07/2015. |
| 40 | Bernard ROUGET, Dominique SAGOT-DUVAUROUX et Sylvie PFLIEGER, Le Marché de l’art contemporain en France, Prix et Stratégies, Paris, La Documentation française, 1991, pp.120-121. |
| 41 | Nathalie HEINICH, Le Paradigme de l’art contemporain, Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard (coll. « Bibliothèque des Sciences humaines »), 2014, pp.214-215. |
| 42 | Nathalie HEINICH et Michaël POLLAK, « Du conservateur de musée à l’auteur d’exposition : l’invention d’une position singulière », in Sociologie du travail, vol.31, n° 1, 1989, pp. 29-50, p.31. |
| 43 | Bernard ROUGET, Dominique SAGOT-DUVAUROUX et Sylvie PFLIEGER, Le Marché de l’art contemporain en France, Prix et Stratégies, op.cit., pp.122-123. |
| 44 | Repères, publié dans le catalogue Daniel Buren, Position – Proposition, op.cit. |
| 45 | Eine Manifestation, Mönchengladbach, Städtisches Museum, 28 janvier - 7 mars 1971. |
| 46 | Idem note 12 ou Daniel BUREN, Les Écrits 1965-2012, volume 1 : 1965-1995, op.cit., p.147. |
| 47 | Idem note 9. |
| 48 | Nathalie HEINICH, L’Élite artiste, Excellence et Singularité en régime démocratique, Paris, Éditions Gallimard (coll. « Bibliothèque des Sciences humaines »), 2005, pp.339-340. |
| 49 | Le « régime de singularité » est un terme avancé par Nathalie Heinich. Voir notamment Nathalie HEINICH, L’Élite artiste, op.cit., pp.101-127. |
| 50 | Les caractères unique et inhabituelle n’ont pas lieu ici d’être définis étant donné que leur attribution est toute subjective. Il s’agit bien de présenter le travail comme unique et inhabituel pour le faire reconnaître comme original par une série d’acteurs d’autorité. Là est tout l’enjeu du paratexte : présenter l’œuvre selon une interprétation et dès lors guider la réception de l’œuvre. |
| 51 | Nathalie HEINICH, « Perception esthétique et Catégorisation artistique : comment peut-on trouver ça beau ? », in Mise en scène de l’art contemporain, actes du colloque organisé à Bruxelles, les 27 et 28 octobre 1989, Bruxelles, Les Éperonniers, 1990, pp.39-50, p.46. |
| 52 | Ibid., pp.46-47. |
| 53 | Gérard GENETTE, L’œuvre de l’art, vol.2 La Relation Esthétique, Éditions du Seuil (coll. : « Poétique »), 1997, p.172. |
| 54 | Loc.cit. |
| 55 | Daniel BUREN, « Absence-Présence, Autour d’un détour », in Opus International, n°24-25, mai 1971, pp.71-73. |
| 56 | Bernard ROUGET, Dominique SAGOT-DUVAUROUX et Sylvie PFLIEGER, Le Marché de l’art contemporain en France, op.cit., pp.123-124. |
| 57 | Pour l’exposition Guggenheim International de 1971, l’œuvre de Buren, Peinture-Sculpture, Works in Situ, a finalement été retirée de l’événement quelques heures avant l’inauguration sur demande entre autres de Dan Flavin et Donald Judd dont les œuvres se trouvaient occultées par la toile rayée haute de vingt mètres et suspendue au cœur du bâtiment. |
| 58 | Florence JAILLET, « L’Affaire Guggenheim dans les correspondances de Daniel Buren », in Françoise Levaillant (textes réunis par), Les Écrits d’artistes depuis 1940, actes du colloque international organisé à Paris et à Caen, du 6 au 9 mars 2002, Paris, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, 2004, pp.83-98, p.90. |
| 59 | Florence JAILLET, « L’Affaire Guggenheim dans les correspondances de Daniel Buren », op.cit., p.90. |
| 60 | Ibid., pp.90-92. |
| 61 | La Lettre de Dan Flavin est largement diffusée par Daniel Buren. Dan Flavin l’a écrite le 19 février 1971 et y accuse l’intéressé de manœuvres malhonnêtes ainsi que de le rendre responsable à tort du décrochage de son œuvre. Voir Daniel BUREN, Mot à mot, Paris, Centre Pompidou / Éditions Xavier Barral, 2002, p.C46. |
| 62 | Florence JAILLET, « L’Affaire Guggenheim dans les correspondances de Daniel Buren », op.cit., pp.90-92. |
| 63 | Jean-Marc Poinsot désigne sous cette expression les textes dont la définition se rapproche fortement de celle de Gérard Genette. Bien que l’objet d’analyse se rapporte exclusivement aux productions d’artistes, la méthode et le regard sur cet objet comportent de nombreuses similitudes avec ceux de Genette. Jean-Marc POINSOT, Quand l’œuvre a lieu, L’Art exposé et ses Récits autorisés, Genève, Mamco ; Villeurbanne, Institut d’art contemporain, 1999. |
| 64 | Daniel BUREN, « Pourquoi écrire ? ou : une fois n’est pas coutume », in Pontus HULTEN (préf. de), Les Couleurs, Les Formes, Paris, Centre Georges Pompidou ; Halifax, Les Presses du Nova Scotia College of Art and Design, 1981, p.5. |
| 65 | Le terme désigne ici, au sens premier, l’action de rendre public, de communiquer à un grand nombre une information. |
| 66 | Le terme médiation désigne les méthodes et plus particulièrement, ici, le discours qui a pour vocation de rendre accessible un contenu non explicite pour un public non-initié à la discipline concernée. |
| 67 | Nathalie HEINICH, Le Paradigme de l’art contemporain, op.cit., p.168. |