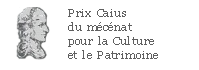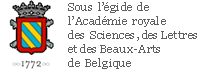FRANCAIS - ENGLISH
Art équestre - Histoire générale - Europe - Histoire de l'art - Sociologie
Daniel Roche
Amazones et cavalières
L'Équitation et le genre (XVIe – XIXe siècles)
Amateur


Daniel Roche
 Auteurs
AuteursBiographie

 Daniel Roche est un historien français, né le 26 juillet 1935 à Paris (14e arrondissement), professeur au Collège de France depuis 1998, dont les travaux portent essentiellement sur l'histoire culturelle et sociale de la France d'Ancien régime.
Daniel Roche est un historien français, né le 26 juillet 1935 à Paris (14e arrondissement), professeur au Collège de France depuis 1998, dont les travaux portent essentiellement sur l'histoire culturelle et sociale de la France d'Ancien régime.Il intègre l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1956. Sur le conseil de Pierre Goubert, alors enseignant à l'école, il réalise son mémoire de maîtrise sous la direction d'Ernest Labrousse, qui lance à cette époque une grande enquête sur la bourgeoisie. Déjà, Daniel Roche fait des archives notariales les sources essentielles de son travail, qui porte sur les catégories socioprofessionnelles à Paris au milieu du XVIIIe siècle.
Il est reçu à l'agrégation d'histoire. De 1960 à 1962, il est professeur au lycée de Châlons-sur-Marne. Pour conjurer l'« ennui1 » lié à cet « exil » champenois, Daniel Roche fréquente les archives municipales et départementales, où il se prend d'intérêt pour les académies provinciales du XVIIIe siècle.
À partir de 1962, et jusqu'en 1965, il est caïman à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, tout en étant chargé de recherches au CNRS. Sur le conseil de François Furet, qu'il fréquente alors, il décide de consacrer sa thèse aux académies provinciales du XVIIIe siècle, sous la direction d'Alphonse Dupront. De ses premiers travaux avec Ernest Labrousse, alors figure majeure et très influente des études historiques, Daniel Roche conserve un positionnement épistémologique influencé par un marxisme nuancé. Il prend notamment une part active dans les débats épistémologiques, mais aussi politiques, qui opposaient l'école labroussienne, partisane d'une approche de la société d'Ancien Régime en termes de classes sociales, à l'école de Roland Mousnier qui défendait quant à elle la primauté des ordres socio-juridiques.
Sa carrière se déroule ensuite à l'université Paris VII (1973-1977), puis à Paris I, où il est professeur de 1978 à 1989. Il est aussi professeur à l'Institut européen de Florence (1985-1989). En 1989, il devient directeur d'études à l'EHESS (1989), avant d'être nommé, en 1998, professeur au Collège de France, où il succède à Maurice Agulhon et devient titulaire de la Chaire d'histoire de la France des Lumières. Il est désormais professeur honoraire.
En tant que professeur d'université, mais aussi comme directeur de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (de 1990 à 20002), ou comme directeur (avec Pierre Milza) de la Revue d'histoire moderne et contemporaine, il a joué un grand rôle dans l'organisation et l'animation de la recherche historique. Il a notamment contribué à la formation d'un grand nombre d'historiens et d'universitaires par le biais de nombreuses directions doctorales.
Reporticles liés